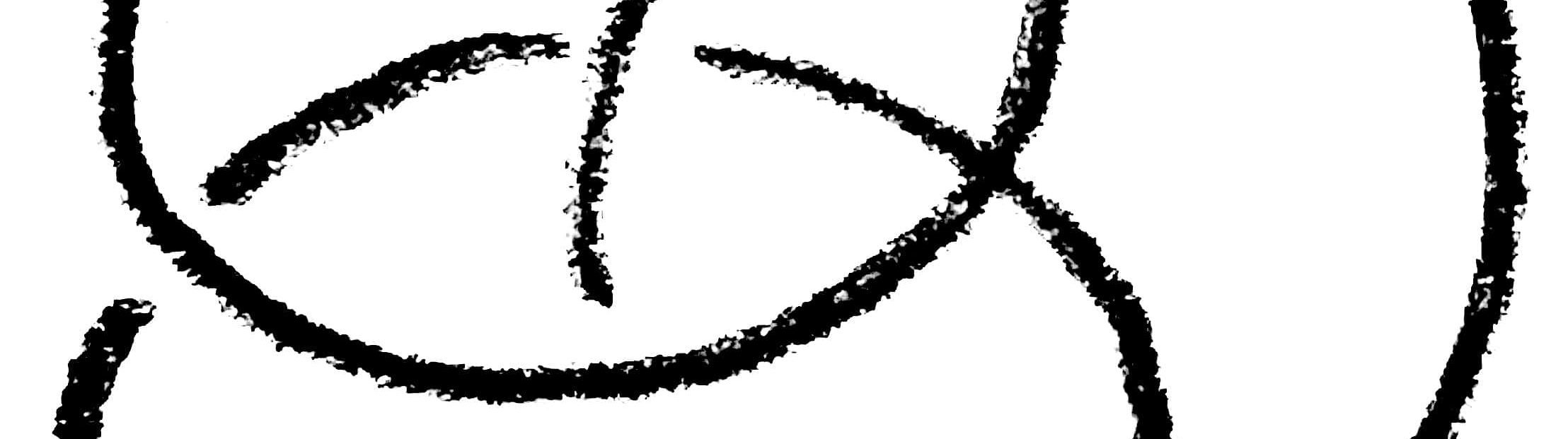JOURNÉES DU COLLÈGE DE PSYCHIATRIE
FÉVRIER 2025
–
Quelques-unes de nos actualités cliniques
« Le texte déchiré de Schreber : un grand texte lacanien »
Introduction aux journées du Collège de psychiatrie
Pascale MOINS
Le 1er février 2025
Ces journées s’inscrivent dans un prolongement souhaité et ouvert de la question du transfert dans la psychose mise au travail lors de la journée de 2024 avec le retour à la lettre ouverte de Schreber à Fleshsig et ce après une journée en 2023 sur les paraphrénies et la paraphrénisation comme mode de stabilisation ou point de butée à la jouissance.
Le titre proposé par Michel Jeanvoine : Actualités des travaux du Collège nous invite à faire valoir ce qu’il en est de l’intérêt actuel de chacun avec ce fil commun ou partagé pour la clinique des psychoses et cet autre fil du séminaire web sem pour une écologie du lien social qui reprend la question de l’écriture dans la théorie psychanalytique et dans la théorie de Lacan .
Comme vous le savez, dans son retour à Freud, Lacan s’est tourné vers la clinique des psychoses et plutôt vers la paranoïa que vers les schizophrénies et leur fameux aspect déficitaire. Il a lié l’étude de l’élaboration de la paranoïa à la formation à l’analyse.
Dès 1955 voire même 1953, Lacan a mis la clinique de la psychose au cœur de son enseignement, dégageant toute la question du langage et de la parole et la manière dont nous sommes déterminés par le langage. Cette spécificité de Lacan est articulée à sa position quant à la transmission et la formation des cliniciens. Mais elle n’est pas dissociable de sa position politique au sein de l’institution psychanalytique, question de discours.
Aujourd’hui, nous écouterons des travaux plutôt orientés par la clinique et la question de la structure, du cas Schreber, du transfert. Demain, des questions tout aussi cliniques liées à la théorie du sujet et au concept de parlêtre, à la question de la langue et des langues puis celle de l’écriture et de sa formalisation en psychanalyse.
Pour introduire ces journées, je vais vous faire part des remarques et commentaires qui me sont venus à partir d’un texte de Jacques Lacan paru en 1966 dans les Cahiers pour l’analyse qui est la présentation de la traduction française des Mémoires d’un névropathe du président Schreber. Je suis tombée dessus et je ne sais pas pourquoi ni comment je ne l’avais pas lu auparavant. Il m’est apparu très intéressant pour reprendre avec Lacan, les psychoses et la question de la psychanalyse, celle de l’écriture avec la langue de Lacan.
L’accueil impatient de Lacan pour cette traduction française
Lacan parle d’une traduction très attendue. Nous sommes en 1966, l’année de son séminaire sur la Logique du fantasme, il est en train de chercher une issue au problème de l’analyse didactique et il a déjà commenté largement le manuscrit de Schreber tout au long de son séminaire sur les psychoses de 1955-1956 soit dix ans auparavant.
Ce texte de présentation est un court texte assez dense où Lacan croise les questions de la traduction, de la fonction de la lecture, de la transmission et de la formation des psychanalystes tout en revenant sur son travail sur les psychoses.
Lacan réinterprète, relit après-coup tant le livre du président Schreber, que l’article de Freud et son propre travail sur la psychose. C’est une occasion de prendre du recul sur tout ce pan de la recherche en psychanalyse et d’avoir une idée plus précise de la succession des scansions épistémiques sur soixante-cinq ans.
Nous pouvons alors suivre une chronologie.
C’est en 1903 qu’est paru Mémoires d’un névropathe, par Daniel Paul Schreber.
Freud s’empare de ce texte en 1910. Il en fait une analyse fouillée qui paraîtra en 1911 dans une revue de psychanalyse (Schreber était alors toujours vivant) et il l’intégrera à son livre Cinq psychanalyses. Freud fait une lecture du livre de Schreber, et en rend compte comme de l’analyse d’un cas pour aborder avec ses outils conceptuels la paranoïa.
Freud distingue déjà psychiatrie et psychanalyse : « L’intérêt que porte le psychiatre praticien à des idées délirantes de cette sorte est en général épuisé quand il a constaté les effets du délire et évalué son influence sur le comportement général du malade ; l’étonnement du médecin, en présence de ces phénomènes n’est pas chez lui le point de départ de leur compréhension. Le psychanalyste par contre … voudrait apprendre à connaitre les mobiles comme les voies de transformation … » (Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa, page 270 .)
En 1955-56, Lacan prend très à cœur la question des psychoses dans son Séminaire III : Les psychoses. Ce séminaire est le troisième si l’on prend la numérotation habituelle, mais dans ce texte de présentation, il en fait le cinquième, (ce qui est le cas si on y adjoint deux séminaires antécédents prononcés au domicile de Lacan devant quelques élèves, consacrés, l’un à L’Homme aux loups, l’autre à L’Homme aux rats).
C’est au début de ce séminaire en décembre 1955 qu’est publiée la traduction anglaise d’Ida Macalpine accompagnée d’une critique des théories de Freud.
Deux ans plus tard, Lacan fait paraître en 1958 dans le numéro quatre de La Psychanalyse « Question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », écrit en décembre 1957 et janvier 1958.
Puis, à nouveau dix ans plus tard, alors que commence son quatorzième séminaire, « La logique du fantasme », il fait paraître ce court texte qui accompagne la parution d’une nouvelle traduction en français du texte de Schreber, par Paul Duquenne et Nicole Sels, deux élèves de Lacan.
« Notre ami le Dr Paul Duquenne », c’est ainsi que le présente Jacques Lacan, qui a poussé, soutenu cette traduction.
Paul Duquenne s’est appuyé sur la lecture raisonnée de la thèse de Jacques Lacan, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité (1936), sur l’article des Écrits, D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose paru dans la Psychanalyse en 1958 et surtout sur le séminaire de 1955-1956, Les psychoses .
Cette traduction a conservé le titre Mémoires d’un névropathe qui vient de la traduction par Marie Bonaparte et R. Loewenstein de l’article de Freud ( 1911), titre qui ne traduit pas très exactement celui de Schreber ( Denkewürdigkeiten eines Nervenkranken ) c’est pourquoi les traducteurs ont proposé un sous-titre « Geste mémorable d’un grand malade des nerfs » ou encore « Gestes et mémorables opinions d’un grand malade des nerfs ». Émeline Fitoussi et René Kalfon avaient mentionné, l’an dernier, cette question d’une traduction plus fidèle que celle de Mémoires par « hauts faits » ou « gestes mémorables » à propos de la lettre ouverte de Schreber.
C’est également Paul Duquenne qui a rédigé la fameuse note pour l’édition française : « Qui, après tout, connait le docteur Schreber ? »
Cette traduction française sort initialement dans Cahiers pour l’analyse n° 5 en 1966 – une publication initiée au milieu des années 60 – dont je dirai un mot un peu plus après et elle ne sera éditée au Seuil qu’en 1975.
Dans cette présentation Lacan écrit : « Disons que le texte de Schreber est un grand texte freudien, au sens où, plutôt que ce soit Freud qui l’éclaire, il met en lumière la pertinence des catégories que Freud a forgées, pour d’autres objets sans doute, et d’un point pour la définition duquel il ne suffit pas d’invoquer le génie, à moins que l’on n’entende par là une longue aisance gardée à l’endroit du savoir» (Présentation p 214.)
Lacan indique là sa fidélité à l’invention de la psychanalyse et son nouveau retour à Freud.
Il y a le grand intérêt de Lacan pour la psychose mais il y a là pour Lacan un enjeu majeur qui est celui de la formation des psychanalystes à travers ce retour vers la clinique des psychoses et de la paranoïa. Ce nouveau retour à Freud n’est pas à lire comme un simple enjeu institutionnel pour Lacan mais comme une histoire de transfert à Freud, une modification de sa position (subjective) vis-à-vis du savoir de Freud.
Et il va évoquer « l’invraisemblable indifférence au texte des Mémoires du Président Schreber » au sein du milieu psychanalytique.
La traduction anglaise et les enjeux de traduction
Lacan évoque dès le début de sa présentation, la traduction anglaise faite par Ida MacAlpine dès 1955 pour pointer que cette dernière « aurait pu prendre son temps ». (Présentation page 213).
En Angleterre, en 1955, Ida Macalpine et son fils Richard A. Hunter publièrent donc leur traduction en anglais des Mémoires de Schreber. Ils sont à l’origine d’une critique très influente de l’interprétation du cas Schreber par Freud, et sont également des interlocuteurs importants pour Lacan. Ida Macalpine a assisté à deux séminaires de Lacan en 1956 (les 27 juin et 4 juillet) ce que ce dernier précise dans cette présentation.
Macalpine et Hunter font également une lecture préœdipienne de Schreber.). Selon leur lecture assez connue, l’objet de l’éviration de Schreber était plutôt de le rendre capable de porter des enfants. Tandis que la castration impliquerait une « stérilisation », ils soutiennent que l’émasculation de Schreber était synonyme de sa transformation en une femme féconde Je me suis référée à un très bon article de Tom Dalzel qui se trouve sur le site des Matinées lacaniennes.
Lacan, quant à lui, a déjà remarqué autre chose, dans leur traduction en anglais, il est mentionné que Flechsig « me donna l’espoir de me délivrer de ma maladie grâce à un sommeil fécond » (Macalpine & Hunter, M., p. 39). En anglais, délivrer signifie aussi : accoucher. Mais en réalité, nous dit Lacan, Schreber n’utilise pas le verbe « délivrer » ; il omet le verbe, ce qui fait dire à Lacan que « Madame Macalpine », comme il l’appelle dans D’une question préliminaire, cherche trop à prouver sa thèse . En d’autres termes, elle veut trouver son thème de la procréation dans le texte de Schreber. Il le décrit en ces mots : « quelle dut être sa joie en trouvant que le texte était si conforme à ses souhaits » (Lacan, 1966).» C’est parce que Lacan est attaché à la question de la transmission du texte et de l’enseignement qu’il souligne le forçage et l’erreur de lecture (et de traduction) de Macalpine à laquelle il rend par ailleurs un hommage appuyé .
« Il est même frappant qu’une exigence de rigueur ne se manifeste jamais que chez des personnes que le cours des choses maintient par quelque côté hors de ce concert, (Lacan vient de parler de conformisme) telle Mme Ida Maclapine qui nous met dans le cas de nous émerveiller , de rencontrer à la lire , un esprit ferme » (D’une question préliminaire , p 58)
Une traduction est une question de déchiffrage et une question de lecture. (Dans une lettre à Fliess (Lettre numéro 52, 1896, La naissance de la psychanalyse) , Freud parle du défaut de traduction que nous appelons en clinique le refoulement / et évoque des inscriptions. Lacan en parle dans le séminaire les Écrits techniques)
Lacan pointe également l’enjeu de la traduction, à savoir ceci que la traduction anglaise a été publiée par Ida Mcalpine, élève d’Edward Glover, qui est une psychanalyste hors du groupe de la société psychanalytique de Londres et que la traduction française va être publiée dans ce qu’il nomme une «zone de frange» que représentent les Cahiers pour l’analyse.
Il souligne ainsi la marginalité des psychanalystes qui se réfèrent au texte de Schreber et soutiennent son importance et sa valeur pour la clinique et la psychanalyse. Elle est aussi un enjeu de transmission pour la psychanalyse.
Il va aussi parler de décalage avec ses contemporains, à propos de la lecture de sa thèse qui a eu lieu dix ans plus tard et seulement dans des milieux avertis (Saint-Alban, Saint -Anne …).
C’est une remarque fréquente de Lacan que celle de ce retard, de ce décalage à être lu par ses contemporains. Cela touche à sa question fondamentale concernant l’enseignement de la psychanalyse. Et l’insuffisance de l’enseignement psychanalytique va de pair avec l’indifférence dite «invraisemblable» au texte des mémoires du président Schreber qui est du même tonneau. Même Mac Alpine une marginale comme lui chez les psychanalystes anglais a publié la traduction de Schreber en 1955.
C’est pour cela que Lacan va nommer ce retard de la traduction française « un acte manqué exprès ». C’est un point tout à fait intéressant pour situer la question de l’acte en psychanalyse. Et il distingue cet « acte manqué exprès » de « l’acte réussi » du névrosé qui lui permet un surgissement de l’Inconscient. Il nomme ainsi l’écart entre l’importance de cette référence pour le mouvement analytique et le retard de la publication. Il dénonce cette absence d’intérêt du milieu psychanalytique pour le texte de Schreber tout comme il a souvent parlé de l’indifférence au texte de Freud. C’est un « acte manqué exprès » au sein de la formation analytique, non conforme à la psychanalyse. La rencontre avec la folie est une clinique qui fait surgir le réel comme impossible à supporter. Aussi c’est un refus de se sentir concerné par le réel auquel le patient a affaire. L’absence de traduction correcte et le retard à la traduction sont des résistances, des résistances à la psychanalyse, un refus de l’inconscient . C’est la grande question de Lacan qui concerne la formation des psychanalystes et la manière dont il la formule très explicitement dans ce texte, sa position et sa responsabilité dans la transmission en psychanalyse.
Je vous propose donc de revenir sur les Cahiers pour l’analyse et le contexte intellectuel et politique de cette parution importante qui a eu lieu de 1966 à 1968.
Les Cahiers pour l’analyse : contexte intellectuel et politique. 1966 – 1968.
Cette présentation des mémoires d’un névropathe écrite par Lacan parait donc tout d’abord dans les Cahiers pour l’analyse, dans le volume cinq de l’année 1966. Il y est mentionné : la publication intégrale des mémoires du président Schreber se poursuivra dans les cinq prochains numéros des cahiers pour l’Analyse.
C’est au début de l’année 1966 que le cercle d’épistémologie de l’école normale supérieure fait paraître le premier numéro des Cahiers pour l’analyse. Son 10 eme et dernier numéro préparé avant mai 68 paraîtra en 1969. Dissidence des cahiers marxistes léninistes (CML) , la revue est partie prenante de la domination intellectuelle de ce qui est unifié alors sous l’étiquette « structuraliste ». Dirigée par un conseil de rédaction composé d’élèves de l’école normale supérieure, étudiants en philosophie. La revue donne une place prépondérante à Jacques Lacan, et plus généralement à la psychanalyse. Les CPA, cahiers pour l’analyse, gardent une visée théorique, même si celle-ci a des objectifs politiques. Mai 68 avec le basculement vers l’activisme maoïste de la majorité de ses protagonistes, en interrompt la parution.
La revue se présente comme une sorte d’entre-deux : entre la radicalité politique, et la réalité théorique, entre le retour à l’apolitisme théorique qui suit la fin de la guerre d’Algérie et le retour à l’activisme politique enclenché par mai 68, entre Althusser et Lacan, entre philosophie classique et nouvelles sciences humaines. Ces Cahiers pour l’analyse n’ont guère suscité d’intérêt académique en France, mais ils sont souvent cités dans les travaux anglo-saxons.
Les quatre fondateurs Regnault, Milner, Grosrichard et Miller suivent les enseignements de Lacan et ceux d’Althusser sur la psychanalyse dès janvier 1964. Lacan commence son séminaire à l’EHESS le 15 janvier 1964. Althusser y envoie des élèves mais si l’on relit ses lettres, il prend toujours soin de « ne pas y assister (lui-même) et (de) savoir rester en coulisses » comme il le dit explicitement dans une lettre (Lettres à Franca, page 517, lettre du 31 janvier 1964, ). En 1964, Lacan, qui a été rayé en 1963 de la liste des didacticiens de la SFP, fonde sa propre école ouverte aux non analystes.
Un mot sur les positions de Lacan et d’Althusser. Lacan est au cœur des questions pour et dans l’analyse (au sens où il interprète toujours ce qui lui arrive institutionnellement avec la même logique de la » boite à outils « qui lui sert à s’y repérer dans l’expérience analytique). Il est mis en marge de la communauté des psychanalystes, il a évoqué une « excommunication majeure », il reste au cœur de ces questions au prix de l’exclusion. Dans une position topologique qu’on peut dire très différente de celle d’Althusser vis-à-vis de l’institution politique ou universitaire. J’avais rappelé cette question d’Althusser dans un autre travail, « C’est le fond de tous les problèmes philosophiques (et politiques et militaires) que de savoir comment on peut sortir d’un cercle tout en y restant » (Les Faits, page 360). Althusser restera au parti communiste avec cette position toujours critique et à l’intérieur du parti, « rester au parti dans une position ouvertement oppositionnelle » (L’avenir dure longtemps, p 268) et ce jusqu’au drame de 1980.
Althusser a publié en 1963 « Freud et Lacan », s’il défend la psychanalyse et la théorie lacanienne, ce n’est pas sans dénoncer le recours paradoxal de Lacan à la caution de philosophes ( Hegel et Heidegger ).
Lacan est très présent dans les CPA, par son séminaire, ses élèves ou ses concepts.
Mais les CPA traitent de philosophie et la présence importante de Lacan, présence sensible, au moins jusqu’au numéro huit, est partie prenante des choix philosophiques. L’équipe des cahiers s’adresse à des lecteurs, potentiels candidats à l’agrégation de philosophie, et au concours d’entrée aux ENS Ulm et Sèvres, et répond aux exigences des épreuves de philosophie à l’écrit et à l’oral.
Un petit texte de Georges Canguilhem est placé en exergue de chaque numéro des Cahiers :
« Travailler un concept, c’est en faire varier l’extension et la compréhension, le généraliser par l’incorporation des traits d’exception, l’exporter hors de sa région, d’origine, le prendre comme modèle ou inversement, lui chercher un modèle, bref, lui conférer progressivement par des transformations réglées, la fonction d’une forme. »
Ce petit cartel va inscrire l’axe des cahiers. La question de la formalisation qui préoccupe tant Lacan est donc très présente dans cette époque et ce contexte. Quelles sont les conditions légitimes de l’extension du concept de discours ? Quels sont les caractères spécifiques d’un discours scientifique ? Y a-t-il des limites à la formalisation ? Quel est l’objet des sciences humaines ? En quels termes penser au présent l’histoire du savoir ? Ce sont les questions qui organisent la réflexion et la recherche dans les cahiers.
Dans le court laps de temps où se préparent et paraissent les premiers volumes des CPA, il y a une effervescence intellectuelle particulière avec une transformation du monde étudiant qui va accueillir un beaucoup plus grand nombre de jeunes, notamment au sein des filières des sciences humaines et une espèce « d’hubris intellectuelle ». Althusser publie « Pour Marx « et « Lire le capital », Foucault, « les mots et les choses », Jacques Lacan ses Écrits, Roland Barthes « Critique et vérité », . Gérard Genet, « Figures », Roman Jacobson préface les textes des formalistes russes. On peut ajouter à la série, « Les Mythologiques « de Claude Lévi-Strauss, avec ce premier volume, « Le cru et le cuit » en 1964 et les » Essais de linguistique générale « de Jacobson paru en 1963.
Ce qui est nouveau, c’est la visibilité des publications, bien au-delà des publics de pairs, matérialisée par le nombre d’exemplaires vendus.
Althusser évoque bien « l’extraordinaire puissance du contact avec les idées ».
Et le journal le Monde va mentionner dans son numéro du 22 février 1967 : « En particulier, depuis le numéro 5, paraît, en » feuilleton « , la première traduction française des » Mémoires d’un névropathe « , du président Schreber, publication qui revêt une extrême importance : c’est en effet le seul document que Freud ait eu en sa possession pour analyser le » cas Schreber « , le seul » matériau » original dont on puisse disposer pour suivre pas à pas l’élaboration de Freud dans ces » Cinq psychanalyses « .
A côté de ce contexte effervescent du milieu étudiant, normalien et philosophique, Lacan ne peut pas guère s’appuyer ni sur le milieu psychiatrique ni pour sur la communauté psychanalytique pour faire entendre son parcours .
Lire et lier trois textes : la fonction essentielle de la lecture
La présentation de Lacan nous invite à lire trois textes , celui de Schreber Mémoires d’un névropathe, celui de Freud Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa ( Dementia paranoides ) (Le Président Schreber ) paru en 1911 et traduit en français par Marie Bonaparte et R. Loewenstein en 1932 et enfin celui de Lacan « Question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » écrit en 1958, paru dans La Psychanalyse , volume 4 et repris dans ses Écrits .
Peut-être, apercevez-vous déjà l’entremêlement, le nouage de ce qu’il en est de la lecture, de la question du sujet, et de la traduction.
C’est à nouveau la question de la transmission qui passe à travers la lecture, lecture du texte de Schreber que nous pouvons lire tout comme Lacan et Freud mais aussi avec la lecture de Freud et la lecture de Lacan. C’est la seule matérialité (« motérialité ») du délire de Schreber. Cependant comment lire et savoir lire ?
A propos du texte de Schreber, rappelons que le passage par l’écrit fait partie du délire et est congruent à la structure du délire. Lacan dit ceci « C’est un délire avec lequel le livre se confond » (D’une question préliminaire). Ce n’est pas un écrit sur le délire. La rédaction, la forme de ce qui est énoncé, la publication font partie de la structure psychotique. C’est dans le travail d’écriture que vient à Schreber la conscience du « meurtre d’âme » (Chapitre 5 des Mémoires), des effets de signification avec sa transformation dans le Soleil en écrivant au Sonnestein (pierre de soleil). Ces remaniements dans l’après-coup de l’écriture sont classiques dans la paranoïa. Lacan l’a déjà dit lors de son séminaire sur Les Structures élémentaires des psychoses « …il s’agit du discours, du discours imprimé de l’aliéné … » (p 19)
Freud conseillait de lire au moins une fois, aussi aride fût-il, le texte de Schreber et c’est la seule chose qu’il en ait connu pour ce cas. « Et c’est ce texte qui porte en lui tout ce qu’il (Freud) a su tirer de révélateur en ce cas » commente Lacan (Présentation p 213)
C’est toute la question de savoir lire, lire le texte du patient qui est le fil de cette présentation de Lacan.
Je cite à nouveau Lacan « Disons que le texte de Schreber est un grand texte freudien, …. Et sa suite « Certes Freud ne répudierait pas la mise à son compte de ce texte, quand c’est dans l’article où il le promeut au rang de cas qu’il déclare qu’il ne voit ni indignité, ni même risque, à se laisser guider par un texte aussi éclatant, dût -il s’exposer au reproche de délirer avec le malade, qui ne semble guère l’émouvoir » (page 214 de la Présentation)
Lacan va lier Freud et Schreber en relevant ce que Freud avait mentionné à savoir que les psychiatres pourraient prendre des leçons de Schreber, et noté l’homogénéité de la théorie des nerfs du Président et celle de la description, construction de l’Inconscient. « Il y a là une rencontre exceptionnelle entre le génie de Freud et un livre unique » (Séminaire sur les Structures élémentaires des psychoses p 19 )
Lacan se retourne sur ces lectures successives pour les interpréter. Lacan lit Freud qui lit Schreber. Nous-mêmes sommes à la tâche de lire Schreber, Freud et Lacan, pour nous éclairer sur cette fonction essentielle de la lecture et nous introduire ainsi à ce que Lacan appelle ici « le sujet comme tel ».
Voici comment Lacan le dit précisément : « L’aise que Freud se donne ici, c’est simplement celle, décisive en la matière, d’y introduire le sujet comme tel, ce qui veut dire ne pas jauger le fou en termes de déficits et de dissociation des fonctions » (Présentation page 214). Pour atteindre le sujet, il nous faudra nous y retrouver avec cet entremêlement (ce nœud) et pour cela il faut savoir lire. Savoir lire comme Lacan nous démontre que Freud a su lire soit « … construire le sujet comme il convient à partir de l’inconscient, c’est de logique dont il s’agit » C’est la logique qu’il faut chercher et trouver dans la chaine signifiante, logique que Freud a révélée et que Lacan situe dans l’énonciation.
La thèse de Lacan, c’est que le sujet de la parole est fondamentalement accroché à un écrit. Le retour à Freud, le retour au savoir de Freud, c’est-à-dire la continuité avec l’hypothèse de Freud, c’est qu’il faut en venir au texte – d’où l’importance de la traduction sur laquelle repose ce petit article des Cahiers pour l’Analyse
Lacan avec Schreber : la question de l’enseignement psychanalytique, théorie et transmission
« Quand nous lirons plus loin sous la plume de Schreber que c’est à ce que Dieu ou l’Autre jouissent de son être passivé , qu’il donne lui-même support, tant qu’il s’emploie à ne jamais lui en laisser fléchir une cogitation articulée, et qu’il suffit qu’il s’abandonne au rien-penser pour que Dieu, cet Autre fait d’un discours infini, se dérobe, et que de ce texte déchiré que lui-même devient, s’élève le hurlement qu’il qualifie de miraculé, comme pour témoigner que la détresse qu’il trahirait n’a plus avec aucun sujet rien à faire -ne trouve-t-on pas là suggestion à s’orienter des seules termes précis que fournit le discours de Lacan sur Freud ? » (p214- 215 Présentation).
Mon propos n’est pas seulement de reprendre les éléments cliniques de la psychose relevés par Lacan (le cri, le hurlement comme la voix privée de toute articulation, le déchirement comme préfiguration de qui devient central dans l’enseignement de Lacan soit le sujet lui-même comme faille, la jouissance du Autre) mais également d’essayer de suivre son cheminement.
Et Lacan d’écrire « Voilà-t-il pas que le texte de Schreber s’avère un texte à inscrire dans le discours lacanien, il faut le dire après un long détour où c’est d’ailleurs que ce discours a rassemblé ses termes. Mais la confirmation en est du même aloi que celle qu’en reçoit le discours de Freud ce qui n’est guère surprenant, puisque c’est le même discours » (Présentation page 215)
Dans ce court texte, Lacan a l’occasion d’une ré-interprétation de son propre rapport à Freud, et sans doute de son rapport à l’expérience analytique. Il critique avec humour la notion dépassée de la connaissance paranoïaque qu’il avait développé dans sa thèse, et montre le franchissement que sa thèse lui a permis dans son propre parcours de psychiatre. Sa thèse de médecine est une « tranchée ouverte », un pas franchi et son refus de la publier dans les Écrits rend compte de sa volonté de se séparer d’avec la psychiatrie universitaire, et témoigne de son accrochage à l’aventure freudienne. Au passage puisque l’affiche de nos journées évoque le mouvement surréaliste, un mot sur Dali, cité ici par Lacan, et qui a construit la « paranoïa critique » comme méthode de connaissance irrationnelle fondée sur l’association interprétative.
C’est sa relecture du cas Shreber qui lui permet de produire sa relecture structurale.
Du texte freudien au discours lacanien.
– Lacan revient sur la résistance, qu’il ne situe pas du tout comme une résistance du moi à analyser chez le patient, vous le savez, mais de façon très précise et sans doute plus scandaleuse du côté des psychanalystes.
Et il évoque « les affres » au niveau de la mathématique en train de se faire soit une nouvelle écriture avec les mathèmes.
Il fait allusion sans le nommer à l’objet a, « le résidu irréductible de la constitution du sujet portée au maximum de son emploi anxiogène par la fonction psychanalysante « (Présentation page 216)
« Ainsi peut – on donner l’idée de la résistance que rencontre chez les psychanalystes la théorie d’où dépend leur formation même » (Présentation page 216)
C’est au fond la grande question pour la psychanalyse qui est une praxis et pour sa poursuite.
Charles Melman dans son séminaire Retour sur Schreber a repris ce point de la résistance des analystes à leur propre théorie « Le milieu des psychanalystes refoule ou forclôt l’enseignement que lui procure sa propre pratique » (page 80 )
– Lacan propose un retour à la clinique des psychoses « la conception du trouble psychiatrique est d’abord affaire du clinicien, ce qu’impose le seul abord de ce texte poignant » (Présentation p 217) d’où l’importance de la position du clinicien. Rappelons ce qu’il avait énoncé dans Question préliminaire : « Cela suppose « une soumission entière, même si elle est avertie, aux positions proprement subjectives du malade, positions qu’on force trop souvent à les réduire dans le dialogue. »
Ne pas trop comprendre, ne pas comprendre au-delà et donc à la place du patient.
On saisit donc l’extrême importance qu’il y a à ne rien comprendre au préalable. Il faut, c’est une exigence, accepter l’inouï de la rencontre avec un texte.
Introduire le sujet comme tel, c’est fondamentalement faire crédit au psychotique, lui faire confiance et prendre au sérieux ce qu’il nous dit.
Si les éditions du Seuil ont rectifié ce que Lacan avait écrit à savoir que le clinicien doit s’accomoder avec un seul « m » à une conception du sujet pour un s’accommoder avec deux « m », il en va d’une affaire de lettre entre s’accomoder, première écriture de Lacan, se mettre à la mode d’une conception du sujet que Lacan introduit et s’accommoder, écriture corrigée du Seuil pour s’arranger, être commode.
Lacan nous avertit à la fin de sa Présentation : « Il ne s’agit là de nul accès à une ascèse mystique, non plus que d’aucune ouverture effusive au vécu du malade, mais d’une position à quoi seule introduit la logique de la cure »
En 1972, Lacan écrira dans l’Étourdit « … mon discours n’est pas stérile, il engendre l’antinomie et même mieux : il se démontre pouvoir se soutenir même de la psychose » (page 494, Autres Écrits, Seuil, Paris, 2001).
Bibliographie
Czermack M., Les psychotiques résistent mal au transfert, Patronymies, Masson, 1998, pp 90-95.
Coll. (sous la direction de Catherine Clément) Jacques Lacan, L’Arc n°58, Réédition . Edition inculte, Paris 2008, 215 p.
Dalzel T., Daniel Paul Schreber dans le monde anglophone, site Les Matinées lacaniennes
Dissez N., Les apologues de Jacques Lacan, PUF, 2022 .
Fitoussi E., De la lettre à l’écrivain, site du Collège de psychiatrie
Freud S., « Le président Schreber », Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1975.
Gorog J-J., Clinique et politique du diagnostic, Revue de Psychanalyse du Champ lacanien, 2005 , N° 2 , pp 244-251
Kalfon R., Ainsi parle D.P Schreber, site du Collège de psychiatrie
Lacan J., « Présentation des Mémoires d’un névropathe », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 213, texte publié initialement dans les Cahiers pour l’analyse, n° 5, novembre-décembre 1966.
Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose » 1958, Écrits, Seuil, 1966
Lacan J., De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, 1936, Paris, Seuil, 1975.
Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par J.-A Miller, Paris, Seuil, 1981
Lacan J., L’Etourdit , 1972, Autres Écrits , Paris Seuil , 2001, pp 449-495.
Matonti F., Retour au concept, le structuralisme des cahiers pour l’Analyse, Raisons politiques 2017/3, n°67, Ed Sciences Politiques , pp 11 -29
Melman C., Retour à Schreber, Séminaire 1994 -1995, Éditions ALI.
Schreber D.-P, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, trad. Duquenne P. et Sels N., Mémoires d’un névropathe, Paris, Seuil, 1975
Tyszler J.J., Quelle est la langue de la psychose ? La revue lacanienne, N° 11, pp 161-162