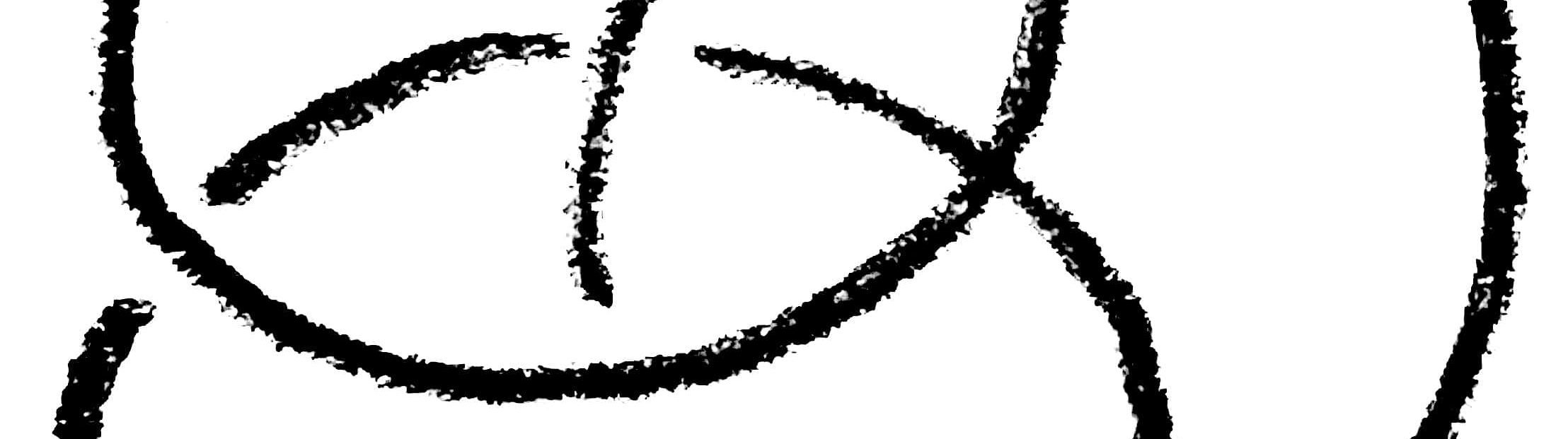JOURNÉES DU COLLÈGE DE PSYCHIATRIE
FÉVRIER 2025
–
Quelques-unes de nos actualités cliniques
« Transfert sous anesthésie ou, anesthésie du transfert. »
Frédéric Scheffler
Le 1er février 2025
J’ai intitulé, mon propos « transfert sous anesthésie ou, anesthésie du transfert ». Je pars de ce titre, mais il m’a semblé, après coup, que je l’ai donné un peu, rapidement.
Ce qui m’a interrogé, c’est le lien entre ces deux signifiants. C’est la nature des connecteurs que j’ai utilisé.
Ce n’est pas évident, d’associer transfert et anesthésie.
Avec DE et SOUS, je trouve que ça ne va pas mal, ça se comprends assez facilement.
Par contre avec ET, transfert et anesthésie, le lien apparaît, porteur de plus d’antagonisme entre l’un et l’autre.
Ce mot, ET, bien sûr, c’est aussi le mot, qui est utilisé pour dénommer une intersection de deux catégories, de deux ensembles, Ici, les ensembles « transfert » et « anesthésie ».
Qu’elle pourrait être la nature de cette intersection, de ces deux termes ?
Alors, ma question a été d’essayer, de chercher et peut être de proposer, un point commun, entre anesthésie et transfert, mais aussi par glissement entre anesthésie et psychiatrie.
Nous ne sommes pas, sans savoir, que cette question transférentielle, dans notre travail, de psychiatre, est actuellement, bien éprouvée, voire rejetée, déniée, par les discours techniques, des neurosciences ou du cognitivisme.
On sait aussi, très bien, depuis Balint, qu’il existe, une dimension transférentielle, dans les soins, y compris, jusqu’au salles d‘opérations.
C’est en relisant un passage, du dernier livre, de Marcel Czermack, « traverser la folie » que m’a pris cette idée, de vous parler d’anesthésie, de transfert, et de psychiatrie.
Je vais reprendre ce passage, ses propos, puisque, c’est écrit, sous forme de dialogue.
C’est dans le chapitre « une clinique de l’objet petit (a) ».
Ce qui, m’avait interpellé, interrogé, c’est qu’il dit :
« Que des médicaments puissent avoir une action sédative, c’est incontestable. » et puis, une ou deux phrases, plus loin
« Mon hypothèse est la suivante. Les neuroleptiques atténuent le caractère irrésistible du transfert. On parle d’antipsychotique. Le terme est faux. Ce ne sont pas des médicaments spécifiques de la psychose. Ils amortissent la brutalité de l’irrésistibilité du transfert à l’endroit de l’Autre. »
Je vais me permettre une petite digression, pour essayer de vous faire entendre, le fil de mes associations :
Il existe, une anesthésie, qui se nomme, une neuroleptanalgésie, c’est une anesthésie qui provoque une sédation légère.
Alors, les signifiants que j’ai associés, de façon toute personnelle, c’est évidemment neuroleptique, sédation, atténuation de la brutalité et anesthésie. Somme toute j’ai entendu qu’une neuroleptanalgésie du transfert permet d’en diminuer la brutalité.
Je précise cela, car il me semble, de prime abord, que l’intersection entre ses deux termes semble, tout d’abord de l’ordre de l’ensemble vide ;
Anesthésie et transfert, d’emblée, tout semble les opposer, leur assemblage, ce serait impossible. Ce serait une sorte de mythe chimérique entre positivisme et théories de l’inconscient.
Si le terme psychiatrie, dans sa définition actuelle, désigne une pratique médiale dédié à l’étude, la prévention et au traitement des troubles mentaux, émotionnels ou comportementaux.
Le terme d’anesthésie, quant à lui, a des significations plus variées, c’est aussi bien la pratique médicale, très technique qui insensibilise, le corps afin de permettre un acte, en général chirurgical mais parfois médical, comme par exemple une sismothérapie. La fonction principale de l’anesthésie est donc d’amortir la brutalité de ces actes, d’en supprimer la douleur.
Ce n’est pas obligatoirement une recherche de la perte totale de conscience. Il existe de simple sédation ou des anesthésies que d’une partie du corps.
Mais ce terme d’anesthésie défini, aussi un état émotionnel, une insensibilité, une apathie morale ou physique.
Je connais, quelques médecins transfuges, qui sont passé de l’anesthésie à la psychiatrie, ou qui se sont impliqué dans la psychanalyse.
L’image sociale de ce changement de parcours professionnel n’est pas très compréhensive.
Le retour qu’on peut en avoir, le plus souvent c’est un mouvement d’incompréhension, une surprise, un étonnement, et on peut s’entendre dire des propos de ce type : « t’étais plus intéressé par l’anesthésie, mais pourquoi la psychiatrie, ça rien n’a voir les deux, c’est l’opposé !».
Certain de vous, doivent avoir connu, René DUPUIS, il est décédé en 2008. René Dupuis, était un médecin anesthésiste, proche de Melman, qui s’était engagé dans la psychanalyse, par un passage sur le divan de Jacques Lacan. C’est ce qu’en dit Charles Melman, dans sa nécrologie, publiée sur le site de l’ALI.
De cette nécrologie, ce que j’en ai relevé, c’est cette phrase :
« Le bonheur de l’engagement politique et le positivisme de la médecine ne lui facilitaient pas l’accès à la psychanalyse. »
Ces propos m’ont interrogé, ce qui me semblait que Melman faisait une opposition entre le positivisme, et l‘analyse.
Par la suite, ce qui m’est apparu, c’est, que ce dont parlait Melman, était plutôt a mon sens, l’exposition d’une difficulté, difficulté d’aller de l’autre côté, de réaliser une traversée.
Mon parcours m’a fait rencontrer, il y a pas mal d’année, René Dupuis. J’étais allé le voir, avec mon petit sac de questions.
La principale était : mais comment fait-on pour passer de l’un à l’autre ?
Il m’avait accueilli, dans son lieu de travail, plutôt exigu et dont, le divan était coincé perpendiculairement à son bureau contre le mur, dans un interstice, d’où émergeait le discours de l’analysant.
Ce jour, je me sens incapable de vous retransmettre cette conversation, ce dont je peux en dire, c’est qu’il m’a raconté, une petite anecdote, de service de suite de chirurgie, le sujet en était la prescription d’antibiotique.
Je n’y ai absolument, rien compris, mais en tous les cas, l’interstice où était logé le divan a permis, à ma rencontre, avec cet homme, dont l’accueil avait été plutôt chaleureux, de m’autoriser à accepter de prendre acte, de ce que je pouvais entendre de mes patients, dans mon exercice, de médecin anesthésiste.
Mais le plus important de ce que j’avais entendu, c’est qu’il était nécessaire d’avoir une écoute psychanalytique au sein de ce positivisme anesthésique, tout comme, en psychiatrie, actuellement.
La volonté de forçage actuelle, vers la somatisation de la psychiatrie, ce déni que ce soit le discours qui donne corps à la relation, déni que c’est dans ce corps que se trouve la souffrance, en fait-elle une spécialité comme l‘anesthésie, c’est à dire une relation bi-réflexive entre un symptôme et un traitement.
De l’anesthésie, ce que je peux en dire, c’est que c’est une spécialité très technique, mais dont la clinique est très frugale en mots mais aussi en signes, la clinique des fonctions est imprécise et pas très spécifique.
Ce qui fait qu’il se greffe un grand nombre de capteurs de mesure, dont celles des éléments de ces fonctions, sur le patient.
Un symptôme, comme par exemple, une baisse de tension artérielle, entraine un protocole thérapeutique, dans une relation de cause à effet, quasiment bijective. La réussite d’un traitement, permet dans la plupart des cas, de faire, à postériori, le diagnostic étiologique.
Depuis le DSM et l’arrivée des neurosciences, nous ne cessons d’alerter sur la disparition, la simplification de la clinique psychiatrique, mais aussi d’une aberration de cette logique de pratique techno-médicale sur le parlêtre.
Les symptômes sont limités à des points d’appels, des signes qui entrainent la mise en place d’un traitement, dit spécifique qui, comme en anesthésie, modèle le symptôme et le traitement à partir de cette relation de cause à effet d’organisation là aussi bijective.
Cette nomination relie, un fonctionnement, imagé par une relation entre des récepteurs biologiques, à des molécules biologiques, c’est à dire des médicaments souvent, parfois un autre type de traitement, j’ai évoqué à l’instant l’électro-convulsivo-thérapie.
Mais cela c’est de la technique. C’est un discours, qui a des effets, un discours technoscientifique, qui est évidemment le même dans ces deux pratiques. C’est un discours positiviste qui a une logique de bande biface.
C’est au regard de cette logique, à mon sens, ce qui fait dire à CZERMACK, que les antipsychotiques ne sont pas les médicaments, spécifiques de la psychose.
« Les psychotiques résistent mal au transfert » pour en parler Czermack, évoque Antoine, qui se laisse choir, d’un balcon des tours de notre dame, « il faut que je me dépasse « retourné en « dépasse toi », retournement de la formule du fantasme ou, « je » deviens « objet (a) » qui faute d’appui symbolique, c’est dans le réel du balcon que le patient réalise, dans un essai de subjectivation, une coupure.
Pour accepter, une anesthésie, il faut d’une certaine manière accepter, de se faire l’objet de l’autre, un autre en position de savoir.
Cet autre, le médecin, c’est un porteur de savoir qui sait ce qui est bien pour l’autre.
Alors donner carte blanche aux porteurs de ce savoir, c’est souvent angoissant, parfois rassurant.
Dans tous les cas, a postériori, ce n’est pas sans effets, évidemment physiques, mais aussi psychiques.
Je ne sais pas, si vous avez déjà assisté, à une intervention chirurgicale,
Au-delà de la fascination, on peut s’interroger, sur la nature de ces corps anesthésiés, ces corps sans discours, qui sont chaud, souple, dont le cœur bat, qui sont vivants mais qui sont incapables de survivre seuls, comme s’ils venaient de mourir.
Il m’est arrivé, un jour, de voir anesthésié un ami, il était méconnaissable, ses traits étaient relâchés, sans expression, comme ceux d’un mort.
Ces corps le sont réellement, ni mort ni vivant, à cet instant, l’être du sujet n’est plus qu’un supposé, qu’à revenir au réveil, son désir est en suspens, dans un pacte de soins où ils sont objet d’intérêt de l’autre, au mieux bon objet réparable.
Ni mort, ni vivant, c’est un état représenté de la façon la plus claire, par les propos, par cette clinique du patient Cotardien. Il présente une clinique de l’objet avec cette altération de la temporalité, il se meut dans l’éternité, à apparaitre ni mort ni vivant.
Alors, peut-être j’ai pu, vous laisse entrevoir un lien possible entre les deux, mais celui-que, je peux vous proposer, est celui-ci : mais pas tout à fait qu’est ce qui anime la vie, ou plutôt, Qu’est ce qui tient en vie.
Cette question, c’est comme la possibilité d’un passage, et pourquoi pas, comme la possibilité d’un tour de barque sur le Styx en compagnie de Charron : chemin entre la pulsion de mort se débarrassant que ce qui tient en vie et la vie.
En incisant de la même question, ces deux savoirs, ce que je vous propose c’est plutôt, que de parler, d’opposition, c’est de parler d’inversion, comme une inversion dans le miroir, les deux faces d’une même pièce tenues par le même bord, pouvant être reliées par cette question, qu’est ce qui tient en vie ?
Je pense que vous l’avez entendu, avant mon expérience professionnelle en psychiatrie, j’ai travaillé comme médecin anesthésiste. Le lieu où j’ai le plus exercé a été dans les maternités.
Le travail en obstétrique ce n’est pas toujours rose ou bleu comme les layettes, ça peut parfois, être franchement noir.
En jour où j’étais en poste, en salle d’accouchement, une femme devait être déclenchée. Son enfant était mort dans son utérus en fin de grossesse.
Ce type d’événement, c’est un drame dans une maternité.
C’était sa deuxième grossesse. Son premier enfant était né sous césarienne. Elle avait immigré dans les zones touristiques du Mexique et était revenue pour accoucher en France.
Malgré sa demande, les obstétriciens, ne voulaient pas réaliser une deuxième césarienne, en effet, les études médicales montrent que l’augmentation du nombre de césarienne entraine une augmentation du risque de rupture utérine lors des grossesses suivantes,
C’est une complication très souvent mortelle, pour la mère et l’enfant, en particulier les longs des côtes mexicaines.
Le protocole du déclanchement comprenait la pose de péridurale, réputée pour aider à la fonction utérine en dilatant le col.
Péridurale posée, les sages-femmes s’activent pour mettre en action chimiquement le travail.
Le travail s’enlise, le temps passe, et la dilatation si attendue, ne s’effectue pas : La tête ne pouvait pas s’engager dans la filière génitale.
On m’appelle alors pour me proposer de réaliser un autre geste, une rachi anesthésie, qui a l’avantage d’avoir un effet beaucoup plus intense et supposée pouvoir entrainer, une dilatation plus efficace.
Je discute alors un petit moment avec cette femme comme je l’avais fait en posant la péridurale, l’analgésie était en place, et si au début de l’accouchement elle m’avait dit être d’accord avec la prise en charge proposée, son angoisse, à la limite de la douleur, à l’instant ou je suis revenu, la voir, lui m’a fait supplier de tout faire pour ne pas vivre cet accouchement par voie basse, c’est à dire de réaliser une césarienne pour que cela s’arrête.
Dans « le corps dans la neurologie et dans la psychanalyse » de Jean Berges, il y a un passage, qui s’intitule accouchement et nouage réel symbolique imaginaire.
Je vous cite une petite phrase que j’en ai tiré, c’est celle-ci :
« C’est à dire ce qu’on appelle filière génitale, c’est le lieu où la fonction motrice procède à l’accouchement et fait passer ces deux objets à la fois : à savoir l’enfant qui risque de mourir et de tuer la mère. C’est en S1 maitre, qui est la mort, que la mère tient son savoir dès la naissance. S2 devient un signifiant de ce que nous appelons mère mortifère dans l’après-coup ».
C’est devant ce refus de cet après-coup, de réaliser d’être la mère d’un enfant mort, que ce S2 fasse retour dans son futur, de devenir dans la réalité une mère mortifère, que cette femme m’a supplié.
Elle a eu une césarienne, j’ai refusé avec elle, ce qui m’a valu son soutien auprès de mes collègues obstétriciens. Soutien bénéfique, car ceux-ci ont été, vous pouvez l’imaginer, plutôt remontés contre moi, d’avoir enfreint les dogmes médicaux.
C’était probablement une solution, une invention de sa part pour qu’elle puisse s’en sortir vivante.
L’horreur de ce réel avait anesthésié l’oreille de mes collègues, il n’y avait pour eux, aucune dimension transférentielle possible, rien en dehors de la logique
médicale : il s’agissait de préserver par tous les moyens l’intégrité du corps de cette femme, les protégeant ainsi d’une relation à l’autre.
Depuis, j’ai changé de spécialité, et j’’exerce en psychiatrie.
En intégrant mon poste actuel sur un CMP, j’ai hérité d’une dame, mon aînée d’une vingtaine d’années. Elle était suivie déjà depuis longtemps. Elle vit dans un petit bourg provincial, vivant maritalement avec un homme, une vie simple de retraités.
C’est une femme d’un milieu social intermédiaire, qui avait une certaine éducation, un peu désuète. Elle faisait des efforts pour venir chez le médecin en se préparant pour avoir une allure respectable.
Dans son dossier, il y avait un diagnostic, de psychose maniaco-dépressive. Elle avait eu quelques épisodes d’excitation psychomotrice avec des éléments de persécution qui avait abouti, à des hospitalisations, quand elle était plus jeune. Elle prenait, un peu comme elle l’entendait, un traitement léger, que je renouvelais.
Les entretiens psychiatriques mensuels étaient au pire, courtois, mais souvent me paraissaient conviviaux. Elle évoquait son ennui avec son époux, dans leur belle maison, et j’écoutais cela avec amusement, j’y entendais les plaintes de Madame Bovary.
Ses propos, pleins de ses sous-entendus me les rendait humoristiques. Elle me faisait parfois quelques remarques sur ma personne, plutôt flatteuses sans être déplacées.
Tout cela me la rendait sympathique, et je pensais que nos entretiens lui apportaient une certaine contenance, un moment d’échappatoire à son ennui, et une hypothétique suppléance. J’étais, je le pense, dans une écoute bien trop compréhensive des allusions qu’elle pouvait me faire, que j’ai pris pour de l’humour, plongeant dans cette connivence, qu’elle avait instaurée avec moi.
Le délire érotomane, décrit par De Clérambault, est basée sur cette certitude qu’« il m’aime », depuis cette position s’est modifiée, pour, comme l’a proposé Étienne Oldenhove « un jour, je ferai « un » avec l’objet » .
Il y eu un moment où cette vielle dame, a commencé à dépenser l’argent du ménage pour venir me voir, frais de coiffure, maquillage, habillement, se présentant à moi avec les meilleurs atours de féminité dont elle pouvait user. Ses propos sont devenus rapidement beaucoup plus figuratifs et insistants.
Des compliments explicites sur ma personne, et des propositions plus inconvenantes, comme son souhait de m’inviter dans un restaurant qu’elle connaissait et où il existait des chambres à l’étage, sa demande devenait de plus
en plus agressive, insistante, pour que nous ayons une aventure ensemble, pour qu’enfin nous fassions UN.
Malgré mes réticences exprimées, comme le fait que je sois médecin et elle patiente, dans une tentative de ma part, de maintien de la disparité des places, de maintenir cette impossible rencontre, son discours se figeait, et me mettait dans une position, que j’ai eu du mal à supporter.
Cet insupportable était lié, aussi, et bien sûr à mes tourments personnels du moment.
Il y a un autre propos de CZERMAK qui m’évoque cette vignette, c’est celui où il dit que « il y a fréquemment chez le psychotique un espace de battement tel que une fois qu’il vous a élu, il est difficile de s’en débarrasser, que ce soit sous forme d’érotomanie, de jalousie ou persécution : une fois que l’objet est trouvé, le psychotique ne le lâche plus. »
En tous les cas, le mouvement de sa pathologie a mis à mal ma position contre transférentielle, je me suis senti submergé par cette dimension psychotique du transfert,
Deux éléments me sont venu, le premier ; je dirais le plus positiviste, c’est qu’il fallait que je puisse lui éviter d’être hospitalisée dans une idée rationnalisante du soin.
Le deuxième, plus intime, c’est que je ne voulais plus rien en entendre.
Du coup, j’ai augmenté de façon sensible son traitement antipsychotique, réalisant une sorte d’analgésie de la brutalité que, je ressentais. Le résultat n’a pas été si mauvais, elle s’est apaisée, et elle s’est désintéressée pour un temps de moi, et j’ai changé mon attitude avec elle.
J’ai évoqué cette vignette non pas pour évoquer un de mes déboires avec une femme qui en plus était psychotique, mais plutôt la difficulté où se trouve la psychiatrie.
Devant cette demande absolue de la psychose, que devient le désir du psychiatre.
Je crois que, comme mes obstétriciens, que la possibilité de faire taire son propre désir, sou couvert du discours technoscientifique, pour obtenir ce que Czermack appelle le désintéressement du sujet psychotique à ce qui l’entoure m’a animé.
Ça a été moyen d’obtenir ma tranquillité, un apaisement de mes propres questions.
Véritable anesthésie du transfert, ce lien animé du désir du psychiatre, faisant taire cette angoisse face au patient, en se justifiant par le discours de cette logique positiviste.
Le bricolage de ces deux vignettes cliniques, me semblaient par ma part, avoir la volonté d’exposer deux mouvements symétriques.
Le transfert, disait Czermack, est préalable à la rencontre, on n’a même pas parlé a quelqu’un qu’il y a déjà transfert.
C’est ce refus d’entendre le point d’impossible que s’anime ce type d’anesthésie ce type du contre-transfert.
Cela confère, a ces deux spécialités, une certaine symétrie, l’un en anesthésie ou il y a eu une possibilité de sortir de cette logique positiviste à l’écoute de la solution de cette patiente.
De l’autre, comment l’impossibilité subjective de pouvoir supporter le discours d’une psychosante a pu faire basculer dans une pratique positiviste anesthésiante.
Je n’en veux rien savoir est déjà aussi du côté du praticien, main dans la main avec l’existence préalable de la relation transférentielle.
J’ai utilisé ce terme de transfuge, précédemment, les transfuges c’est ceux qui trahissent, qui passent dans un autre camp.
Je pense que Vous vous souvenez de ce film de Spielberg relatant l’échange d’espions entre les Etats-Unis et l’Union soviétique sur un pont à Berlin. (le pont des espions), le transfuge c’est un peu comme ses espions : c’est quelqu’un qui passe une frontière.
Comment aller de l’autre côté d’une bande biface si ce n’est par une coupure, pour transformer celle-ci en bande de Moebius.
Qu’est ce qui peut faire coupure, en dehors d’un balcon, comme le patient de CZERMACK, bien sûr, si ce n’est un discours.
J’espère que vous avec entendu que comme pour René Dupuis que pour ma part ça été aussi d’aller sur un divan que cette coupure s’est faite.
Mais je pense qu’il y a peut-être d’autres chemins.
Est-ce que la psychopathologie, permet cette coupure ?
Je peux aussi questionner sur la pratique des analyses de la pratique, ou des présentations cliniques.
Pour ma part c’est évident qu’aujourd’hui que ces éléments puissent faire coupure dans ce positivisme imperméable actuel.
Une coupure qui peut permettre aux soignants à s’autoriser, non pas à se défiler devant leur fonction, mais d’en assumer, pour certains, pleinement le désir.