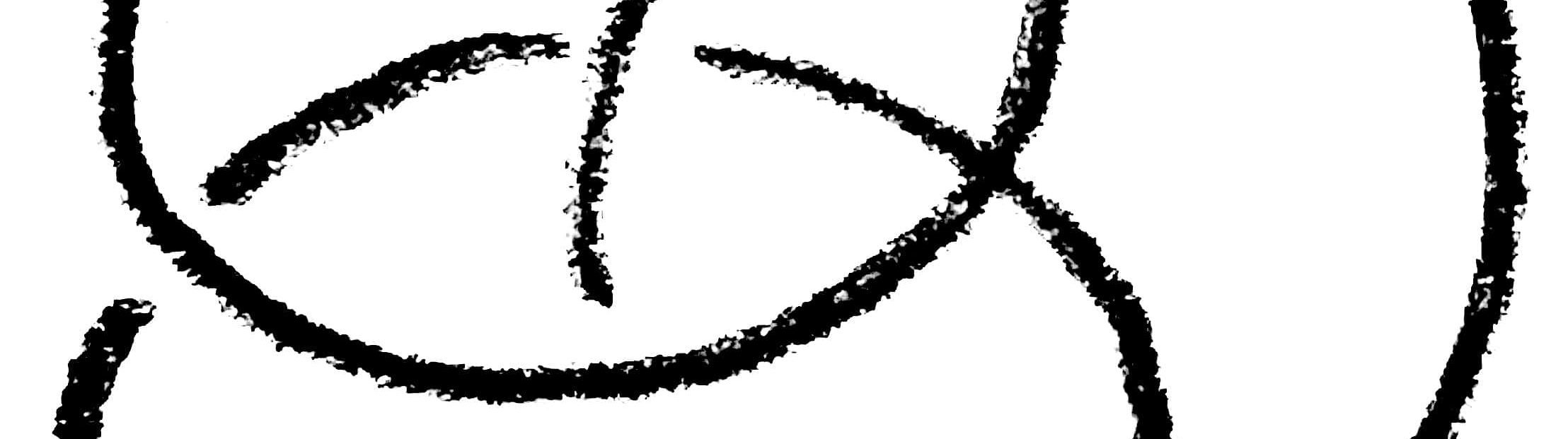JOURNÉES DU COLLÈGE DE PSYCHIATRIE
FÉVRIER 2025
–
Quelques-unes de nos actualités cliniques
« Le non-dit de Schreber »
Cyril VARGAS
Le 1er février 2025,
Je tiens à vous remercier pour m’avoir invité à partager avec vous quelques réflexions sur le texte de Schreber, durant quelques minutes. Et je remercie également Emeline FITOUSSI pour son séminaire sur Schreber, qui nous donne l’occasion de réfléchir sur ce célèbre et imposant témoignage de la psychose que sont les Mémoires d’un névropathe, de Daniel Paul Schreber.
La lecture de ce texte étant, je trouve, assez compliquée, je me suis interrogé sur ce qui pouvait y manquer, pensant trouver là quelque élément intéressant. Ainsi m’est venue l’idée de parler du non-dit de Schreber.
Commençons par voir ce que peut recouvrir la notion de non-dit, en particulier chez Schreber :
1) On peut entendre le non-dit au sens d’implicite contexte culturel ou personnel de l’auteur, et ce peut être l’objet de travaux de recherche et d’études en sciences humaines. On peut entendre par non-dit, les sous-entendus volontairement présents dans le texte.
2) On peut aussi entendre le non-dit de Schreber comme l’échec de sa volonté de tout dire, de tout expliquer.
3) Comme non-dit de Schreber on peut comprendre aussi ce que l’on pouvait attendre dans le dit de Schreber mais qui ne s’y trouve pas. Ce sont des éléments qu’il semble avoir évité alors qu’ils peuvent paraître évidemment le concerner dans le cadre de son propos.
4) Je vous rapporterai également le cas d’un non-dit de Schreber, un non-dit clairement entendu par lui.
5) Enfin par non-dit de Schreber on peut entendre le »nom (N-O-M) dit de Schreber », ce que je comprends comme étant la question »de quoi Schreber est-il le nom ? », pour plagier le titre d’un livre qui date de 2007 (« De quoi Sarkozy est-il le nom ? » par Alain Badiou).
Je commence par cette dernière question.
Déjà, »de quoi Schreber est-il le nom pour la psychanalyse ? » Visiblement, c’est le nom d’un texte qui a intéressé tous les psychanalystes, Freud et Lacan entre autres, et a nourri les théories ou au moins leur a offert un terrain de mise à l’épreuve, et une gageure pour l’interprétation psychanalytique depuis que Freud a montré l’exemple. L’étude de ce texte est quasiment un passage obligé pour tout psychanalyste, et Charles Melman, dans son texte « De l’aventure paranoïaque : le cas Schreber »1, de 1963, fait une liste, partielle sans doute mais déjà longue, d’études des Mémoires faites entre 1911 et 1963.
Ensuite, »de quoi Schreber est-il le nom pour Schreber lui-même ? » Là, s’ouvre un vaste sujet qui parcourt tout son texte puisque celui-ci rapporte les hauts-faits de l’auteur dans son rapport conflictuel avec Dieu, avec des concurrents, des doubles et où sa filiation semble égarée, au-delà du temps et de l’espace, en étant en lui-même un lieu de rapports de forces (son corps et son esprit sont-ils des lieux, d’ailleurs ?), et pour finir par trouver un accord avec Dieu sur sa transformation en femme génitrice d’un nouveau peuple. Cela me semble être une question à laquelle tout le monde s’attelle depuis la publication des Mémoires.
Dans ce qui suit, je me contenterai de ne parler que du non-dit de Schreber.
D’abord, du non-dit de Schreber en tant que contexte culturel, on peut dire que pour Schreber ce n’est guère un non-dit, mais plutôt un dit-explicite, car la rationalisation de son délire emprunte à de multiples auteurs de son temps des idées, du vocabulaire, et des représentations.
Quelques exemples en vrac : la notion de nerf comme transmetteur d’une onde, idée du milieu de XIX-ième siècle où l’onde est l’électricité ; le satellite Phobos de la planète Mars (paragraphe [77]), dont la découverte a été faite en 1877 par un astronome américain ; la guerre franco-prussienne de 1870 ; le Traité de psychiatrie de Kraepelin daté de 1896 ; la notion de force d’attraction évoquée de nombreuses fois (notion qui date du XVII-ième siècle) ; le nationalisme allemand, propre à la fin du XIX-ième, qui perce quand il considère le peuple allemand comme le nouveau peuple élu de Dieu (paragraphe [14]) ; des références à des textes de Goethe, de Lord Byron, de Darwin, et autres ; des commentaires sur les progrès techniques récents et inconnus de Dieu ; etc.
De manière similaire, Schreber explicite de nombreux détails qui ont trait à sa vie personnelle, au point qu’un chapitre entier a été censuré à la première publication car parlant de sa vie sexuelle et de celle de sa femme. Ce chapitre semble bel et bien perdu. On peut même dire que Schreber ne cache rien de sa vie personnelle et de ses pensées, que sa pensée semble à ciel ouvert, tant pour nous que dans le monde où il se décrit. Et de plus, des sous-entendus, on en recherche encore tant l’effort continuel de Schreber a été d’expliciter et d’expliquer ce qu’il voit, perçoit ou pense.
Toutefois, Schreber ne parle que du présent ou de sa maladie, il ne dit quasiment pas un mot du passé (en dehors de quelques éléments et des épisodes passés de sa maladie). Ça ne semble pas entrer en ligne de compte dans son objectif de sortir libre de l’hôpital psychiatrique ou pour partager ses « idées religieuses » avec sa femme. Mais il n’est pas impossible qu’il en ait parlé dans le chapitre censuré.
Alors, le non-dit de Schreber semble être son passé hors maladie, ce qu’il dit de lui sans savoir qu’il le dit -tout cela intéresse la psychanalyse- et ce que à quoi on pouvait s’attendre et qui ne s’y trouve pas. Le passé hors-maladie aurait été très intéressant, visiblement, Schreber n’a pas vu de lien avec sa maladie. Freud a essayé quelques liens (miracle du hurlement, …) entre passé et maladie, à la suite de Lacan, une autre approche prévaut aujourd’hui. Sans doute, le non-dit chez Schreber est involontaire, car tout au long de son texte il cherche à dire, expliciter, expliquer tout ce qu’il peut, afin dit-il dans son introduction, de partager ses « idées religieuses » avec son entourage, mais c’est sans doute surtout parce que c’est pour lui-même une contrainte permanente.
Au début du chapitre XVII, dans les paragraphes 228 à 230, Schreber décrit la mécanique mentale qui le contraint à se demander le pourquoi du comment de ce qu’il perçoit, disant « il n’est vraiment pas facile de trouver à leur pourquoi une réponse juste qui puisse satisfaire l’esprit humain ». Les deux mots « leur pourquoi » souligne une fois de plus -dans ce texte- que ces pourquoi sont xénopathiques : ce sont des injonctions qui viennent de ses nerfs ou qui font « intrusion » dans ses nerfs. La fin de la phrase « satisfaire l’esprit humain » explicite ce qui permet d’arrêter l’insistance de ces pourquoi. Je souligne que cet « esprit humain » à satisfaire ne correspond pas aux poseurs de questions -qui sont ses nerfs, qu’il ne vit pas vraiment comme intérieurs à lui-même, ou qui sont explicitement extérieurs même à ses nerfs- et que l’on peut supposer que cet esprit humain est quand même le sien. Dans d’autres phrases, il explique que si la réponse est trop banale, ses nerfs ne sont pas satisfaits et continuent alors à être insistants. Mais alors qu’est-ce que « satisfaire l’esprit humain » dans ce qu’il nous présente ? C’est sans doute trouver les bonnes phrases, des signifiants articulés dans un discours détaillé sur les « causes » (c’est son mot) et clouant le bec aux questionnements oppressants. C’est une recherche d’un discours qui répond à une demande d’exclure le Réel, c’est-à-dire à obturer toute ignorance en s’affirmant comme savoir complet, donnant du sens à toute chose.
Schreber parle pourtant beaucoup de miracles : qu’est-ce que la notion de miracle pour lui ? Au paragraphe 9, il parle du « pouvoir miraculaire du Dieu créateur », il semble que le miraculeux est un événement qu’il n’arrive pas à articuler à son savoir accumulé, à ses signifiants, contrairement à ce qu’il arrive à faire pour beaucoup d’autres choses. Cela correspond assez bien avec la notion de miracle dans la religion chrétienne. Le signifiant « miraculaire », s’il est une traduction fidèle au texte allemand, est un néologisme qui réunit miraculeux et ordinaire, et qui sans doute signifie que le monde doit beaucoup à l’intervention directe du Dieu créateur, mais aussi, du fait que c’est un néologisme, qui souligne le caractère inexplicable de ces interventions.
Un exemple de miracle : dans le chapitre XVII, il détaille ce qu’est pour lui « dessiner », cela s’apparente pourrait-on dire à une capacité à se créer à volonté et quotidiennement des hallucinations visuelles, plaisantes voire jouissives, sans qu’il n’en ébauche la moindre explication et il qualifie ce « dessiner » de « miraculeux ».
Quelques mots sur « le miracle du hurlement » :
Freud, dans une lettre à Fliess propose une interprétation du « miracle du hurlement » : ce serait un retour d’une expérience de son enfance où son père, tyran domestique, hurlait sans qu’il en comprenne la raison. On peut toutefois lire que ce miracle se produit quand le dieu se retire et se tait. À la suite de Lacan, et de Charles Melman (20 octobre 1994), on pourrait dire que ce dieu par ses « rayons » bavards, qui parlent et interrogent sans arrêt, permet à Schreber d’avoir un monde perçu structuré de signifiants mi-imposés mi-réfléchis, et que l’éloignement du dieu laisse le monde silencieux, ce que l’on peut aussi comprendre comme laissant le Réel à nu. Le hurlement de Schreber serait alors celui de son angoisse devant le Réel, et la dernière possibilité pour lui de manifester la vie de son être face à une mort psychique imminente. Et ce hurlement est dit « miraculeux » dans la rationalisation du délire, car apparaissant quand il n’y plus de signifiants, il n’y a donc pas d’argument ni de cause pour Schreber, par contre il est qualifié de « miraculeux » pour faire lien avec Dieu qui est l’ultime lien logique et signifiant.
De manière similaire, dans la note 37, il parle d’une « apparition miraculeuse » qui l’a jeté dans « un haut degré d’angoisse ».
Un « miracle » serait alors ce qui ne peut être justifié ou expliqué, les moments d’angoisse, sans signifiant, en font partie.
Et d’ailleurs, qu’est-ce que justifier ou expliquer pour Schreber ?
Il a des connaissances par voix de nerfs, par expériences intimes, et qu’il expose à ses lecteurs. Ce sont ses connaissances sur Dieu, les nerfs, le fonctionnement des êtres de l’Univers dirais-je globalement. Les nerfs, et leur fonctionnement, semblent correspondre aux chaînes signifiantes, nous dit Melman, donc ce type de connaissances, bien que délirantes, paraît basé sur une certaine perspicacité de Schreber, ce qui force l’admiration, il faut bien le dire.
D’un autre côté, d’autres connaissances viennent de ses réflexions suite à des questions, des injonctions d’explications posées par ses nerfs ou introduites dans ses nerfs par les voix. Mais qu’est-ce qu’une explication doit satisfaire ? Il écrit que cela doit satisfaire « l’esprit humain » ; on comprend : son esprit à lui ou ses nerfs, ce qui est plus ou moins la même chose, suivant les pages. En partant de l’idée que ça doit satisfaire son esprit à lui et regardant quelques-unes de ses justifications de causalités, il me semble qu’en définitive ses explications mettent bout-à-bout toutes les connaissances qu’il a pu accumuler dans sa vie sur le sujet questionné, connaissances qui sont assez nombreuses, et que ce qui le satisfait ce n’est pas tant le fait d’avoir comblé tous les trous possibles et imaginables dans les relations causales, c’est sans doute plutôt le fait d’avoir usé de tout son savoir sur le sujet évoqué, et accumulé -ce savoir- avant sa maladie. Par exemple, au sujet des étymologies, il explique y avoir intensément réfléchi suite à des questions posées par les nerfs, mais aussi qu’il s’y est beaucoup intéressé avant d’être malade.
Cette limitation (au savoir accumulé) a, pour nous, une apparence de rationalité, mais elle peut rester énigmatique si l’on veut bien oublier que la connaissance ne peut être complète que quand la loi des signifiants est respectée, notamment ses évidences. Et cette loi n’est qu’un héritage social.
De plus, Schreber écrit ([228]) que les contraintes qui lui étaient imposées étaient au-delà des « possibilités humaines » mais qu’il en avait des « compensations » par « l’effet de stimulation intellectuelle » et l’accès aux « lumières » concernant les « choses surnaturelles » qui valent « tout l’or du monde ». On lit là une jouissance dans la souffrance imposée par le Grand Autre, une forme de sublimation de cette souffrance et une mise en ordre de son savoir acquis durant sa vie, et de son imaginaire dans le but de donner du sens au Grand Autre qui, non castré, dénie tout manque, tout trou dans les discours signifiants.
Ainsi, ce non-dit de l’au-delà des explications et des recherches de causalités, est soit l’indicible car faisant face au Réel, soit le non-questionné dans son héritage culturel et social, dirais-je.
Je tiens à souligner que ce qui n’est pas non-questionné dans l’héritage culturel et linguistique est toujours le Réel, le gouffre sans fond du tout-est-possible, du grand-n’importe-quoi, le chaos.
Cela me rappelle une histoire :
« Le grand Euclide donnait un jour une leçon et entre autres sujets il parlait du monde. Le jeune Ptolémée, sans conteste le meilleur élève de sa classe, leva la main et lui demanda sur quoi le monde reposait.
-Il repose, répondit Euclide, sur les épaules d’un énorme géant.
Ptolémée baissa la tête et la classe continua. Un moment plus tard, le jeune Ptolémée releva la tête et se permit de demander sur quoi reposait le géant.
-Il repose, lui répondit Euclide, sur la carapace d’une énorme tortue.
Et aussitôt, sans attendre une autre question de son élève, Euclide ajouta en élevant sévèrement la voix :
– Et au-dessous, il n’y a que des tortues. »2
Le non-dit de Schreber comme élément qu’il semble avoir évité de dire alors que c’était un élément central dans ce que l’on connaît de lui, c’est surtout, je pense, la loi (Gesetz), et, dans une moindre mesure, le droit (Recht).
D’après ce que j’ai pu lire3, Schreber n’écrit que deux fois le signifiant loi, alors que son travail quotidien était justement la loi. Même dans son Introduction, où il explique les motivations de l’écriture de son texte, il ne parle pas de jugement, de loi ou de droit, bien que l’on comprenne qu’il s’agit -aussi- de plaider sa cause auprès d’un tribunal pour obtenir sa sortie de l’hôpital psychiatrique.
Schreber, durant tout son texte, parle d’un dieu ou de deux dieux qui règnent sur le monde d’une manière ou d’une autre, en tout cas qui gèrent le monde, qui sont en quelque sorte au centre de ce monde, mais sans émettre ou dicter de loi.
Le dieu chrétien ou juif est un dieu émetteur de lois qui, à de nombreuses reprises, fait du droit par ses jugements exposés dans la Bible. On ne peut que s’étonner que Schreber évoque un dieu, des dieux, l’univers sans qu’aucune loi ne soit évoquée, ni même le signifiant loi (sauf deux fois dont je dirai deux mots), et que les personnages soient soumis à Dieu sans qu’aucun élément de loi ni de droit ne soit évoqué. Ou presque, puisqu’il parle d’un « ordre de l’univers » et d’un « droit naturel », dont je dirai aussi quelques mots.
Rappelons-nous ce qu’est une loi, ce qu’est que le droit, et mettons cela en rapport avec la maladie de Schreber. D’abord, la loi est émise et mise en œuvre par une instance supérieure à celui qui y est soumis. C’est à une telle instance supérieure que Schreber était censé appartenir et où il n’a pas pu tenir son rôle. Ensuite le droit c’est toujours du Verbe qui gère (ou est supposé gérer) le monde, c’est-à-dire la réalité, en bordant le Réel. La justice est toujours une application du Verbe au Réel tel qu’il se manifeste, et c’est toujours une problématique que d’arriver à qualifier les gestes, qualifier les actes, qualifier les intentions et les faits pour les faire rentrer dans le droit et les soumettre à la loi.
La loi et le droit sont faits de signifiants, ils sont donc une coupure dans la réalité qui elle est une continuité. La réalité décrite par Schreber confine à la continuité : les nerfs forment une continuité entre les vivants, les morts, et les Dieux ; il n’y a d’ailleurs pas d’intérieur ni d’extérieur chez l’individu ; la langue fondamentale confond les opposés ; si Schreber tient à dater ses souvenirs, l’ordre temporel, notamment générationnel, semble aboli ; de nombreux événements lui arrivent parfois des milliers de fois par jour ; il prend un soin inattendu et ambiguë à distinguer les paroles et les sons ([236] et [237] : les oiseaux miraculeux et le soleil parlent, et que ce n’est pas le cas des trains, ni des bottines, etc) ; il se transforme en femme, de manière plus ou moins continue, tendant ainsi à abolir la distinction entre les sexes.
Le droit et la loi sont supposés soumettre la réalité, mais, dans son texte, Schreber ne semble pas chercher vraiment une loi, et il n’y a pas de loi ni de droit dont il dirait que les faits les suivent.
La différence avec la Bible est flagrante : elle débute par « Au commencement était le Verbe », et Dieu y articule sa loi par son verbe, sa parole, avec lesquels il forge la réalité à partir du Réel, il juge ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Par ces faits, le Dieu de la Bible est tout puissant, mais aussi transcendant.
Chez Schreber, il n’y a pas de transcendance de Dieu, il y a une continuité entre Dieu et l’humain, cette continuité est décrite à travers les nerfs qui vont de l’humain jusqu’à Dieu, la composition de l’humain est la même que celle de Dieu. Les nerfs entre eux semblent séparés, séparables, distinguables, mais les nerfs semblent continus et relient Dieu et l’humain. Un humain peut prendre l’ascendant sur un autre en maîtrisant ses nerfs, il y a des batailles de maîtrise de nerfs entre humains, entre un humain et Dieu, voire une mise en cause de la suprématie de Dieu par un humain. D’ailleurs, il n’y a pas de morale dans cet univers, pas de bien ni de mal qui soient reconnus par Dieu, ni récompensés, et on peut dire qu’il n’y a ni totem ni tabou.
A ma connaissance, il n’y a pas de culture où les dieux ne sont pas transcendants, toujours les dieux luttent entre eux, et le rôle des humains est s’y soumettre, ou de les amadouer, au mieux de jouer les uns contre les autres. Les dieux de Schreber ne représentent pas la loi du monde, ils règnent dans les faits, par une sorte de rapport de force continu, et ils sont même mis en défaut par « l’ordre de l’univers ». En référence à Lacan, on peut dire que Dieu comme père mort émetteur de la loi, c’est raté.
Au [60], Schreber écrit « là où l’ordre de l’univers est rompu, la puissance reste seule maîtresse du terrain, et c’est la raison du plus fort qui règne. » et il accuse ensuite Dieu d’immoralité : « Ce qui qu’il y avait de moralement choquant dans mon cas, c’est que Dieu lui-même avait dérogé à l’ordre de l’univers sur lequel lui aussi pourtant doit se régler ».
Ce que nous, nous pourrions appeler loi dans l’univers de Schreber, ce sont des règles de fonctionnement des nerfs, et surtout c’est ce qui s’impose à Dieu lui-même qui est un « ordre de l’univers » auquel tout le monde est soumis, un ordre dont la règle est écrite nulle part, qui est implicite, jamais formulée.
Chez Schreber il n’y a pas de coupure dans la réalité, il n’y a pas de transcendance de Dieu, et si les nerfs représentent quelque chose en lien avec les signifiants (Melman les identifie aux « chaînes signifiantes »), ils sont une continuité décrite comme matérielle. Le refus de la loi, en tout cas du signifiant loi dans le texte de Schreber s’illustre donc par cette continuité de son univers. De fait il n’est pas surprenant que Schreber, psychotique, refusant la coupure du signifiant et la chute qui va avec, exclut la loi de sa représentation de l’univers, alors même que c’était son métier avant son internement.
Et, du coup, la question se pose de savoir comment il a pu exercer ce métier, avec un talent reconnu qui plus est, durant de nombreuses années. L’hypothèse connue est que, dans sa psychose, il ait cherché la loi et le milieu du droit comme appuis tant pour sa pensée que pour son comportement, mais qu’une fois arrivé au sommet d’une hiérarchie, avec toute la symbolique paternelle que cela comporte, il a fait une décompensation qui l’amène au délire que l’on connaît et à un internement durable.
Si Schreber ne reconnaît pas de lois dans son univers, sauf une loi d’attraction des nerfs et des rayons, et une « loi de renouvellement des rayons » [116], dont je dirai un mot, il lui reconnaît un « ordre », qui s’impose à Dieu lui-même, et un « droit naturel » dont Schreber lui-même devrait bénéficier.
Ce que Schreber appelle l’ordre de l’univers correspond à l’ordre du langage, à la loi du signifiant nous dit Melman. Ce que l’on peut comprendre en lisant les [184] et [185], c’est que si l’ordre de l’univers est mis en cause par Dieu, c’est qu’Il est entré en contact avec Schreber avant même que celui-ci soit mort. Ce que l’on comprend, c’est que Dieu ne parle qu’aux personnes subjectivement mortes. Dès lors, Schreber ne trouve pas ou plus sa place subjective, et il doit se plier, corps et âme, à la mécanique du signifiant débité à flux continu par le Grand Autre qu’est ce Dieu.
Le « droit naturel » revendiqué par Schreber pour son propre bénéfice est « le droit de ne penser à rien » (fin du [181], p 154), droit dont la mise en défaut est détaillée notamment dans le chapitre XIII, on y apprend « l’incapacité de comprendre l’être humain comme organisme » par les deux Dieux. Cela exprime en creux qu’il connaissait ce « ne penser à rien » avant d’être malade, ou du moins quelque chose d’approchant. Après sa décompensation, il semble que Schreber a été capable d’obtenir cet état de manière transitoire en s’occupant (« dessiner », jouer au piano, etc), mais cela semble finir souvent par une angoisse et un « miracle du hurlement ». Une question que l’on peut se poser est de savoir s’il pouvait en être autrement pour lui, et même pour nous névrosés si l’on prend l’expression « ne penser à rien » au pieds de la lettre.
Jean Périn, dans le séminaire du 16 février 1995 de Charles Melman, détaille les origines médiévales de la notion juridique de « droit naturel », et il dit que visiblement Schreber les connaissait. Dans la tradition judéo-chrétienne, ce droit naturel est, pour le résumer, le droit qui s’impose à la raison en dehors même des commandements de Dieu4. On conçoit bien alors que cette revendication, cette opposition à Dieu, au Grand Autre, est une expression de la subjectivité de Schreber qui prend ainsi un appui sur un signifiant du droit.
Quant aux deux apparitions du signifiant loi, elles se trouvent [30] quand il parle d’une loi de l’attraction entre rayons et nerfs, et dans l’expression « loi de renouvellement des rayons » [116], je m’étais dit dans un premier temps que c’était les exceptions qui confirment la règle, mais en y regardant de plus près, j’ai pu lire :
– Dans le [30] « La force d’attraction, cette loi impénétrable dans son essence la plus intime, impénétrable même pour moi et en vertu de laquelle les rayons et les nerfs s’attirent les uns les autres, recèle en son germe une menace pour le règne de Dieu, menace dont une figuration allégorique fournit sans doute déjà la base de la légende germanique du Crépuscule des Dieux. » Soit donc une loi qui met en danger Dieu.
– Et dans le [116] on apprend de la « loi de renouvellement des rayons » que c’est « un principe fondamental – dont à ce qu’il paraît, procédaient les « petits hommes faits d’esprit Schreber »- en vertu duquel de nouveaux rayons peuvent jaillir… » : le signifiant loi concerne donc des « petits hommes faits d’esprit Schreber » qu’il porte « dans son bas-ventre », c’est-à-dire que ce signifiant apparaît quand Schreber envisage déjà d’enfanter, perspective qui sera l’issue de son état le plus délirant, qui le ramènera à un certain calme, à une certaine civilité, et sans doute à une certaine assurance quant à la survie de sa subjectivité.
Enfin, voyons un non-dit, ni par Schreber ni par ses voix, mais quand même entendu par lui :
Au paragraphe [109], Schreber rapporte l’anecdote suivante « Je me souviens d’avoir un jour jeté par la fenêtre, cassant sans doute un carreau du même coup, le plat (de saucisses grillées) qu’on avait placé devant moi ; je ne m’en rappelle plus à présent clairement le motif. »
Dans le texte allemand, le morceau de phrase « le plat (de saucisses grillées) qu’on avait placé devant moi » s’exprime par deux mots « vorgesetzte Gericht » et une parenthèse respectée dans la traduction. Mot-à-mot, ces deux mots signifient « tribunal supérieur » et ce sens change en « plat supérieur » en ajoutant le contexte de la parenthèse « (Bratwurst) » qui indique que l’on parle de saucisse. Cela vient du fait que le mot Gericht signifie tribunal ou plat (de nourriture) suivant le contexte. Si on voulait se rapprocher de ce qui s’apparente à une ambiguïté du texte en allemand de Schreber, une autre traduction de « le plat qu’on avait placé devant moi » pourrait être quelque chose comme « le plat de qualité jugée supérieure que l’on avait placé devant moi ». Schreber manifeste d’avoir bien entendu la référence au « tribunal supérieur » dans son propre dit, en jetant ce plat par la fenêtre, sans pour autant ni l’avoir dit ni l’avoir compris, alors même que ses parenthèses -à lui- proposent une séparation des deux mots juridiques du contexte culinaire ; de plus il « ne se rappelle plus à présent le motif », alors que sa mémoire semble infaillible durant tout son texte, disant qu’il pourrait citer des milliers de noms de personnes qu’il a rencontré à travers les connexions de nerfs, etc. Cette anecdote semble bien nous raconter un passage à l’acte par un effet du signifiant5.
Pour conclure : en voulant traiter le sujet de tout ce que n’a pas dit Schreber dans son texte, je me suis rendu compte qu’il y avait de quoi déborder largement des deux jours de ce séminaire, et comme je suis mû par une certaine modestie, j’ai voulu réduire mon propos pour laisser un peu de temps pour les autres, et, déjà, pour mon intervention, je vous remercie pour votre patience.
Post-scriptum sur les occurrences du signifiant Gesetz dans le texte allemand de 1903 :
Pour bien saisir le problème du comptage de ce signifiant, il faut tenir compte de deux choses : des mots en allemand peuvent être construits par concaténation de mots, c’est-à-dire par un collage les uns aux autres, suivant certaines règles grammaticales, pour donner ainsi un nouveau mot au sens qui peut être plus ou moins éloigné de ses composants ; le terme Gesetz, qui signifie loi, regroupe les deux notions de loi qui sont présentes en allemand, la loi formelle (qui parle d’un acte de volonté) et la loi matérielle (qui parle du contenu d’une norme juridique qui réglemente le comportement).
Dans le texte allemand, il y a aussi deux occurrences de Gesetz seul. La première correspond à la traduction en français « loi d’attraction des nerfs » au paragraphe [30] ; la seconde a été traduite par règle dans la phrase en français « … la formule qui exprime cette règle : « n’oubliez pas que la nature des rayons est qu’ils doivent parler » a très tôt été serinée… » au paragraphe [130], ce qui semble correspondre à Gesetz compris comme loi formelle, soit acte de volonté. Ce deuxième Gesetz est dans un long paragraphe descriptif où il n’y a nulle trace de mise en cause de Dieu.
Dans la traduction en français, la seconde occurrence de loi (au paragraphe [130]) vient du mot « Strahlenerneuerungsgesetz » traduit par « loi de renouvellement des nerfs », qui résulte d’une concaténation de mots et qui est traduit comme une loi matérielle (norme à suivre), comme peut l’être, par exemple, « Gravitationsgeset » qui est traduit par « loi de la gravitation » (de Newton). Les autres occurrences de la suite de lettres gesetz sont inclus dans des mots plus longs, et sans lien apparent avec la notion de loi (par exemple le mot gesetzt, qui signifie ensemble, et ses dérivés grammaticaux).
Je pense ainsi convaincre le lecteur que mes observations au sujet du signifiant loi est peu tributaire de la traduction en français de ce texte, dans la mesure où l’on peut faire les mêmes remarques concernant le texte allemand, à condition toutefois de distinguer les deux significations du mot Gesetz, comme l’ont fait les traducteurs.