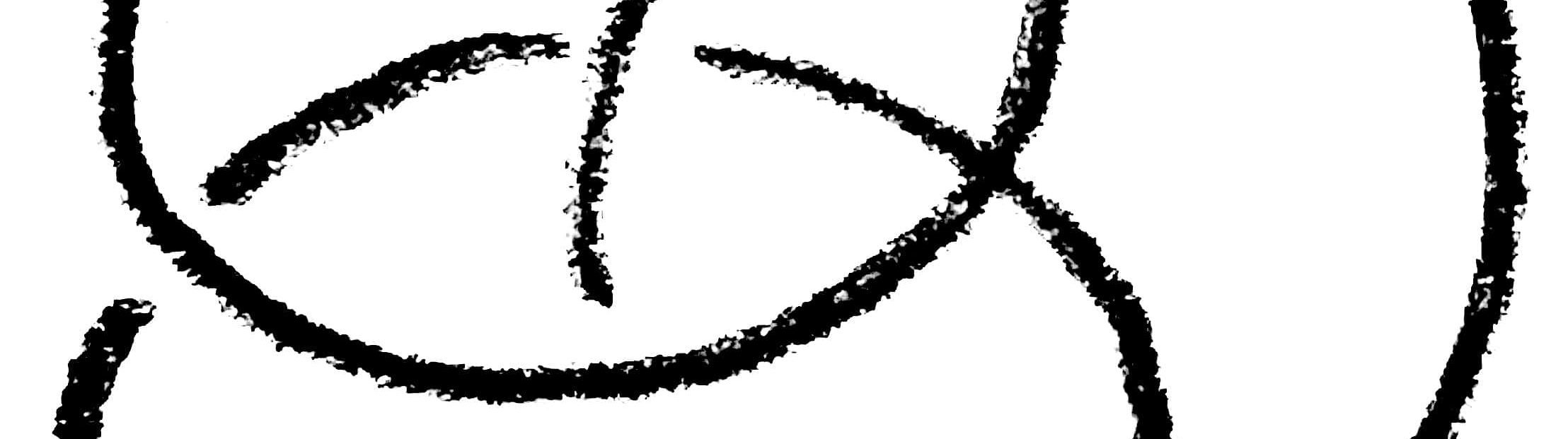Une présentation du “Temps logique”
de Jacques Lacan.
Michel JEANVOINE
–
–
Voilà, avec ce titre, « Une présentation », la porte proposée par laquelle nous introduire au travail de ces journées consacrées au « temps logique » de Jacques Lacan.
Tout d’abord « Une », de “Une présentation”. En effet, faut-il rappeler que ce travail relève d’une lecture, une lecture qui, comme toute lecture, ouvre à un reste ? Plus précisément c’est une lecture qui fait bord à un reste et ouvre, ainsi, l’espace d’une “ disputatio”, espace d’une “disputatio” qui permet à chacun de tisser ses questions avec ses éléments de réponse.
Et puis « présentation », au sens fort de la présentation où celle-ci, comme J.Lacan nous l’apprend, vise moins à cerner un sens qu’à lui donner une place, à ce sens, dans ce qui peut faire et fait nouage. En effet la présentation n’est pas la représentation, celle-ci, la présentation, releve d’une lecture qui prend en compte le Réel en jeu dans cette affaire, soit alors la lecture d’un bord, ou encore, en suivant ce bord pas à pas, de tout un parcours qui donnerait sa place à ce Réel, invention d’écriture dont, non seulement nous parle Lacan, mais dont celui-ci vient témoigner très tôt dans son parcours. « Mon sophisme » avait-il pu dire.
Avant d’entrer dans le vif de ce texte il nous faudrait alors dire quelque chose de ce bord, soit de la place de celui-ci dans les plis de son enseignement, jusqu’à son terme, et comment, ce sophisme le tisse et le tresse, tel ce fil rouge dans les cordages de la marine anglaise – ou les cailloux du « Petit Poucet »- en y pointant régulièrement, et dans un après-coup, les traces de la prise d’un appui.
Si tout commence, pour ce texte, à l’automne 1945 où il est publié dans une revue confidentielle qui reparaît pour un première fois après le conflit de 40, les « Cahiers d’Art », Lacan n’était pas déjà sans s’intéresser de près à la question du temps, et à la temporalité. Avec la clinique de la psychose qui interroge tout spécialement la question de la temporalité, les travaux des phénoménologues Binswanger, Minkowski, ou des philosophes Heidegger par exemple- la question du temps, dans les années trente, est dans l’air. Mais c’est seulement après avoir fait fraîchement son entrée dans le champ analytique à Marienbad que celui-ci s’autorisera en 45 d’un pas, discret, avec la publication de ce texte dont les plis s’ouvriront tout au long de son parcours et jusqu’à son terme. Comme si ce texte avait été le dépositaire d’une intuition que celui-ci n’avait pu, mais que progressivement et seulement dans un après-coup, qu’en déplier toutes les subtilités et le tranchant.
En effet, dès 49, nous pouvons en trouver les premiers échos avec les précisions et le recentrage apportés au « Stade du miroir » qui devient alors, pour le jeune infans, dans une cristallisation anticipatrice de son lien à l’Autre, l’identification spéculaire. i(a) se met en place dans la précipitation anticipée avec, en son cœur, un non spécularisable, (a), témoin de son nouage à la dimension du symbolique.
Et nous pourrons suivre à la trace, une trace qui pourra prendre quelques fois la dimension d’une simple évocation, nous pourrons suivre à la trace le sillon de ce texte dans quasiment chacun de ses séminaires.
Cependant en 1966, à l’occasion de la publication des « Écrits », une réécriture de ce texte nous est proposée. Celui-ci, avec son écriture très précise, sans artifice, au plus près des méandres de sa monstration, n’est pas sans évoquer, par sa rigueur, un autre texte « L’étourdit » . Comme si ces deux textes pouvaient, au-delà des années qui les séparent, se répondre. La publication des “Écrits”, avec la réécriture de ce texte et l’ajout de commentaires topologiques à la “Lettre volée”, apparaissent comme le témoignage d’une ponctuation dans son parcours. Une lecture topologique, structurale, initiée par une lecture de la clinique du mythe et du fantasme semble trouver, avec la topologie des surfaces (bande de Moebius et cross-cap) sa maturité. Peut s’ouvrir alors une nouvelle séquence, un nouveau temps du tressage de son travail avec une invention d’écriture, R, avec RSI. Donner une écriture, et donc faire une place à “ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire”: c’est avec ce coup de force que s’initie la topologie borroméenne. Et le nouage Bo se propose, à la lecture, comme lui-même rythmé par ces temps logiques. Comment entendre autrement le parcours de Lacan, lui-même, qui clôt son enseignement sur “Le moment de conclure” et “La topologie c’est le temps”? Jusqu’au terme de son enseignement celui-ci assumera les termes de ce tressage par lequel il est entré dans le champ de l’analyse. “Comment nouer l’Imaginaire au trou du Symbolique, et au Réel de la rencontre du non-rapport ?”telle semble avoir été sa question, dépliée tout au long de son parcours. Autrement dit, “qu’est-ce qu’un trou ?”, une question simple à quoi se résumerait la psychanalyse.
Mais si ce texte, cet écrit, comme je vous le propose, vient faire bord dans ce parcours, dans ce tressage, que contient-il ?
Où en est plus précisément le tranchant ?
De quoi viendrait-il nous parler, sinon, du principe même susceptible d’ordonner un tel parcours, son parcours ?
Voilà donc cette hypothèse que nous pourrions soutenir: ce texte viendrait nous parler du principe même qui ordonne tout parcours, donc le sien, pour un être parlant pris dans la mise au travail de la question du signifiant.
Et c’est l’hypothèse de lecture que j’aimerais soutenir avec vous ce matin.
Prenons le temps d’examiner ce “nouveau sophisme” en nous appuyant sur le texte de sa réécriture de 66.
Une lecture comparative entre les textes de 45 et 66 nous a fait prendre la mesure de l’intérêt plus spécifique porté par Jacques Lacan à la mise en valeur de certains aspects insuffisamment soulignés dans le texte de 45. En effet, tout se passe comme si la maturité acquise sur la topologie des surfaces en 66 lui permettait d’introduire plus de rigueur et de précision dans cette réécriture. Nous verrons sur quels points précis cela portera.
Entrons dans la lecture de ce texte.
Il nous faut faire cet effort, car il y a là, manifestement, un effort à soutenir, une forme d’horreur, qui touche à la nature même du propos.Et il importe de pouvoir la prendre en compte.Celle-ci n’est pas sans lien avec celle, soulignée par Lacan, de l’horreur en jeu, pour l’analyste, dans son acte. Il y va, me semble t-il, d’un même déplacement du sujet. Mais ne nous précipitons pas, soulignons simplement que nous ne pouvons pas nous y avancer impunément, puisque c’est de la rencontre de nos impasses logiques que celui-ci progresse. C’est une des raisons pour laquelle, me semble t-il, le terme de “nouveau sophisme” s’impose à Lacan, terme indispensable à la présentation de cette nouvelle fonction logique qui va mettre en jeu ces différentes modalités du temps.
Comme vous le savez, elles sont, pour Lacan, au nombre de trois, l’instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure.
Et c’est par cette voie, celle de ses impasses logiques, que le sophisme s’impose avec sa solution faite de ces différentes modalités temporelles qui prendront leur statut de véritable temps logique. Disons le d’emblée, il est beaucoup moins question d’une logique du temps que d’un temps qui, dans ses différentes modalités participerait d’un travail de logique et ainsi se hisserait au statut de temps logique conduisant, dans la précipitation, à une assertion de certitude anticipée.
Il nous faut bien alors y faire, avec vous, un premier tour afin d’en dégager ce qui en fait la spécificité et ce qui donne ainsi à ce texte toute sa valeur et son intérêt , pour que celui-ci, J. Lacan, avec constance, y fasse retour et y retrouve ses appuis jusqu’à ses derniers séminaires, le « Moment de conclure » et la « La topologie c’est le temps ».
Deux points principaux , à souligner, spécifient cette réécriture de 66.
Un premier, tout d’abord, sur la manière dont se définissent les trois prisonniers, A, B, et C. En 66, on appelle A le sujet réel qui vient conclure pour lui-même; B et C ceux, réfléchis, sur la conduite desquels A établit sa déduction.
Un deuxième point, essentiel, et nous y reviendrons dans notre propos, concerne le statut de signifiant accordé à deux scansions suspensives , ou motions suspensives . Ceci vient témoigner clairement de la lecture topologique de ce parcours, faite en 66, avec ses élaborations du moment. J’évoque ici la topologie des surfaces avec la bande de Moebius et tout spécialement sa double boucle supportant la coupure signifiante que ces deux motions suspensives présentifieraient dans la genèse de cet acte identificatoire.
Comme vous le savez, il est question d’une prison avec son directeur et ses trois prisonniers. Celui-ci les réunit en promettant la liberté à celui, qui, le premier, pourra dire, et expliquer logiquement, de quelle couleur est le rond qu’il porte au dos. Il y a trois ronds blancs et deux ronds noirs et, point essentiel, les prisonniers n’ont pas le droit de se parler.
Une solution logique dite « parfaite » s’impose comme une première réponse.
En effet après un « certain temps » les trois prisonniers sortent ensemble en tenant, chacun séparément, le même propos :
« Étant donné que mes deux compagnons de prison étaient des blancs, j’ai pensé que si j’étais un noir chacun d’eux eut pu en inferer ceci: « Si j’étais un noir, moi aussi, l’autre, y devant reconnaître immédiatement, devant les deux noirs, qu’il est un blanc, serait sorti aussitôt. Or il ne sort pas, donc je ne suis pas un noir. » “Et tous deux seraient sortis ensemble, convaincus d’être des blancs.” “S’ils n’en faisaient rien, tous les deux, c’est que mon hypothèse de départ était fausse et que je suis blanc comme eux. Sur quoi, j’ai pris la porte, pour faire connaître ma conclusion. »
Et c’est ainsi que tous trois sont sortis simultanément forts des mêmes raisons de conclure.
Il est à noter que c’est seulement par l’invalidation d’une hypothèse, l’hypothèse” je suis un noir” qui s’avère fausse, que ce procès logique peut opérer. De la rencontre de ce « ce n’est pas ça” essentiel au parcours -« je ne suis pas noir »- pourra en tomber une conclusion, « je suis blanc », qui ponctue cette « solution parfaite » en conduisant chaque prisonnier, partageant la même épreuve, vers la sortie.
Cependant Lacan, pointe, avec ce premier départ, les insuffisances, voire les erreurs d’une telle démarche logique qui caractérisent cette solution dite « parfaite » et il complexifie le problème en donnant, au transitivisme en jeu, toute sa place.
Si A, ayant sous les yeux B et C sortants, s’avance vers la sortie à son tour avec ce temps de retard lié au travail du regard, l’idée ne peut que lui venir que leur sortie (à B et C) ne lève pas totalement le doute sur le fait qu’il ne soit pas noir (A). En effet, B et C, constatant un A noir, se pensant dès lors blancs par la même démarche logique, seraient t également sortis. Comment faire la différence, pour A, entre ces deux sorties motivées différemment et être sûr que cette sortie fait de moi, A, un blanc ?
D’où, après un premier départ, cette réflexion qui introduit un doute et donc un premier arrêt, Lacan dira une première scansion suspensive, ou encore une première motion suspensive.
Chacun refait alors le même raisonnement en prenant en compte, cette fois-ci, le fait que chacun soit livré à une même hésitation due à ce temps de retard lié au travail du regard qui porte sur le comportement des deux autres. Soit alors, si B hésitant ne sort pas avant moi, c’est que celui-ci ne m’a pas vu noir, et que mon hypothèse est fausse, et je serais donc blanc.
Et chacun, une nouvelle fois, se dirige vers la sortie en un nouveau départ.
Et chacun, devant le départ des deux autres, se trouve à nouveau envahi par le même doute, d’où un nouvel arrêt, une deuxième scansion suspensive.
B s’est arrêté une première fois pour vérifier son raisonnement, et si j’étais effectivement noir, celui-ci sortirait sans hésitation. Or une nouvelle fois il est dans l’expectative partagée avec C…
Il me faut donc mettre un terme à ce temps de retard qui fait le lit de cette expectative partagée. En effet, ce temps de retard lié à la transitivité en jeu, sous mon regard, entre B et C, se trouve redoublée, par la prise en compte obligée de la transitivité dans laquelle je suis moi- même engagé avec B et C. Mettre un terme à ce temps de retard obliterant toute conclusion ouvre cette précipitation conclusive et anticipante sur toute cettitude. En me comptant il me faut conclure avant B et C pour lever cette expectative et ouvrir une certitude. Une certitude, anticipée par l’acte qui se vérifiera dans l’après-coup de cette précipitation conclusive.
Il est à noter que cette précipitation subsume et rassemble les modalités temporelles précédentes de l’instant de voir et du temps pour comprendre, et participe, ainsi, pleinement – en tant qu’instance temporelle – d’un travail de logique. C’est en cela que l’instance temporelle, dans le dépliage de ses différentes modalités, participe de ce parcours obligé et caractérise la nouveauté radicale de ce sophisme, puisqu’il peut faire des erreurs et des impasses de la solution parfaite, en les positivant, un élément d’écriture qui noue d’une manière neuve temps et espace: à savoir un nouveau sujet produit dans un acte, mieux, produit dans la mise en œuvre d’une logique de l’acte, et ouvrant ainsi la voie à une nouvelle identification à un trait: « blanc »!
Quelques remarques essentielles.
Tout d’abord une toute première: c’est ainsi que s’ouvre le berceau d’un nouveau sujet, une nouvelle matrice symbolique pourra dire Lacan, comme il nous le propose très tôt, dans son texte sur le Stade du miroir en 1948. Cette logique de l’acte rend compte de l’identification spéculaire qui noue, mythiquement, et pour une première fois, l’Imaginaire à la dimension du trou du symbolique, introduisant ainsi le jeune sujet à la dimension du manque.
Ensuite il est à noter que c’est seulement dans un après-coup que surgit une commune mesure- « je suis blanc »- partagée par chacun. Il y a là une dimension d’universel, sur laquelle il faut pouvoir nous arrêter, générée par ce parcours singulier et commun caractérisé par la rencontre d’une même impasse, d’un même “c’est pas ça”, d’un même non-rapport. Tout d’abord par la nécessaire invalidation de l’hypothèse du départ, « je suis noir », et puis avec les deux arrêts ou encore la succession des deux scansions suspensives témoignant d’une incompatibilité temporelle. Devant un temps de retard rendant la conclusion impossible une assertion s’impose dans la précipitation , une assertion portant sur une certitude qui se vérifiera dans un après- coup.
Ces deux scansions, soutenons le terme, signifiantes, témoignent du progrès logique spécifiant le tranchant de ce sophisme, en ceci que, dans un premier temps, A soutenant sa fausse hypothèse, aurait sous les yeux B et C se livrant à leur temps pour comprendre transitivé avec le seul noir restant. Lequel des deux serait le noir restant ? Telle serait leur question partagée avec la réponse qui s’imposerait pour l’un des deux, “je suis blanc”, devant la présence des deux noirs, permettant sa sortie. Or il n’est rien de tout cela. D’où cet arrêt de B et C ouvrant la conclusion de A, “je ne suis pas noir”.
Après avoir eu sous les yeux le jeu transitivé de cette hésitation avec B et C, A est amené à en faire lui-même l’épreuve dans son non-rapport à B+C avec ce temps de retard. Lui apparaît alors que ce temps de retard oblitére toute conclusion possible et s’ouvre la voie obligée d’une sortie précipitée en mettant un terme à ce temps de retard, générant l’incertitude et l’impossibilité de conclure. Ce temps de retard, lié au jeu de l’instant de voir, se trouve alors pouvoir être compté pour ce qu’il est, soit une modalité structurelle et non pas seulement conjoncturelle. En effet ne serait- il pas possible de donner à ces deux scansions suspensives , lecture suggérée par la réécriture de Lacan, le statut d’une répétition signifiante? C’est-à-dire leur donner le statut d’un même trait, celui du “c’est pas ça “, soit, en les mettant en continuité, donner à ces deux scansions le statut d’une double boucle, ou encore d’une coupure signifiante. Nous aurions, là, la présentation topologique du statut du sujet telle que Lacan pouvait l’articuler en 66, voire plus précisément la mise en jeu d’une fonction, celle qui préside à la naissance d’un “neue Subjekt”.
Ainsi se creuse la place d’un nouvel espace-temps qui ne peut s’écrire, ou se construire, que dans l’urgence et la précipitation.
La lecture d’un (-1) fondateur, pourrait-on dire, nouant un nouvel espace-temps, trouve là sa légitimité. Un nouveau sujet avec son nouvel objet h(a)té, une conclusion de travers, pourra dire Lacan un peu plus tard !
Ainsi s’ouvre une voie originale pour rendre compte de l’identification et donner toute sa place à une première conception de l’acte.
Encore une remarque : rappelons que pour Lacan il s’agit d’un collectif, d’un collectif vivant qui trouve, là, avec ce trait d’identification qui s’avère dans l’après-coup commun, à faire communauté par le partage d’un même trait. Et nous avons, là, avec ce texte sur « Le temps logique », une voie pour rendre compte de comment un collectif peut faire communauté, mais aussi, réciproquement, comment une communauté peut se renouveler, dans le tissu identificatoire qui l’organise, en faisant vivre, ou revivre, la dimension du collectif, en réintroduisant le non-rapport avec sa prise en compte à chaque fois particulière, mais qui pourtant s’avère, dans un après-coup commune . Faut-il préciser que ce non-rapport spécifie, au delà de ses multiples présentifications, l’ordre du signifiant ? Et ceci n’est pas sans nous évoquer, bien sûr, ce qu’il en sera un peu plus tard pour Lacan, l’invention, avec le “Tout “, du « pas Tout », essentiel à tout lien social, puisque c’est d’un trou que celui-ci se supporte.
La solution lacanienne ainsi proposée en réponse à Freud n’est pas sans élégance. Là où Freud nous proposait un trait d’identification au chef , une voie s’ouvre qui nous permet de penser la genèse d’un trait d’identification par l’assomption de la rencontre d’un non-rapport.
Dans ce procès qui conduit à un jugement assertorique sur une certitude anticipée il y a un saut, un jump, un travail d’écriture devant la rencontre du non-rapport, dont la continuité d’un raisonnement logique ne peut rendre compte et qui spécifie le sophisme dans son appel à un temps logique. Une logique toute particulière spécifie le sophisme, celle de pouvoir positiver cette vraie rencontre, c’est-à-dire celle du le réel, et peut se prête, ainsi, à une lecture topologique. Celle-ci pourrait s’éclairer avec le nouage Bo conçu comme nouage par l’écriture d’un-1. C’est-à-dire l’écriture d’un réel qui ne cesse pas, cependant, de ne pas s’écrire.Un lien étroit semble nouer sophisme et topologie Bo, telle que Lacan nous la met en main en en faisant une présentation, et non pas une représentation. Je ne développe pas ce point mais seulement l’indique en le laissant à de futurs travaux.
Cette solution lacanienne, avec ce travail qu’il n’aura de cesse de déplier tout au long de son parcours, vient radicalement poser le sujet parlant comme le produit du collectif et, en même temps, ce collectif comme n’étant rien, que le sujet de l’individuel.
Lacan concluera son texte en évoquant la dimension proprement civilisationnelle de ces enjeux comme la forme logique de toute assimilation « humaine », forme logique capable d’assimiler la barbarie. Peut-être sommes-nous en mesure de mieux l’entendre ? En effet si nous pensons la barbarie comme le déchaînement d’un réel, celui d’un non-rapport fondateur délibérément ignoré, la civilisation se donne à être pensée comme la mise œuvre de cette écriture d’un réel qui ne cesse pas, pourtant, de ne pas s’écrire. Le mouvement de la civilisation ne serait-il pas autre chose qu’une mise en place du trou du symbolique à un meilleur endroit et ainsi pouvoir calmer cet appel sauvage à la pulsion de mort?
Mais ceci suppose alors ce que souligne Lacan dans sa conclusion, conséquences directes de ce dépliage du temps logique :
- “un homme sait ce qui n’est pas un homme” . Je sais que “je ne suis pas noir”.
- “les hommes se reconnaissent entre-eux pour être des hommes”. C’est dans un après-coup que je me découvre blanc au même titre que les deux autres prisonniers.
- “je m’affirme être un homme, de peur d’être convaincu par les hommes de n’etre pas un homme”. C’est par la précipitation de mon départ, pour mettre un terme à mon retard qui rend impossible toute conclusion, que s’affirme et se manifeste la certitude, anticipée, de mon “ne pas être noir “, donc “blanc”.
Voilà ce que je voulais vous présenter pour introduire notre sujet et ouvrir cette “disputatio”. Cependant il me faudrait dire combien je remercie Erik Porge, qui a, non seulement, bien voulu répondre à notre invitation, mais pour la qualité de ses travaux sur cette question avec ce livre, aujourd’hui malheureusement épuisé, paru chez Èrès dans les années 90, et intitulé “Se compter trois”.