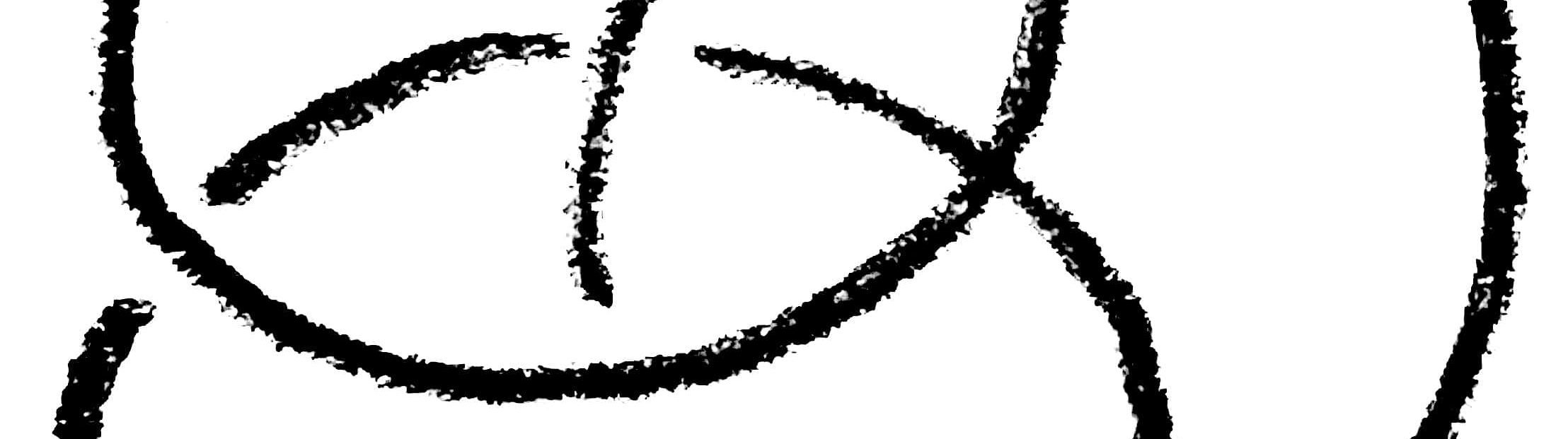JOURNÉES DU COLLÈGE DE PSYCHIATRIE
FÉVRIER 2025
–
Quelques-unes de nos actualités cliniques
« Une ponctuation »
Michel JEANVOINE
Le 2 février 2025
Il ne nous reste que très peu de temps pour conclure ces journées, aussi je ne vais pas pouvoir, non seulement vous dire ce que je voulais vous dire, mais je me trouve dans la nécessité de prendre quelques raccourcis.C’est ainsi, et pourquoi pas. Et je ne peux que vous renvoyez à un travail déjà ancien, daté, eh oui ! intitulé “Un point c’est trou !”, vous le trouvez en ligne sur Google, ne pas oublier le point d’exclamation !
De fait, je me trouve aujourd’hui en charge de cette conclusion et j’ai préféré lui donner le titre de “Une ponctuation”. Titre qui, après ces deux journées très riches de travail du Collège- et j’en remercie vivement tous les artisans- s’imposait.
En effet, qu’est-ce que ponctuer?
Le champ sémantique est très large et il est possible d’y retenir ce trou d’épingle qui se proposait à la lecture en faisant écriture.
Alors quels liens avec la question de l’écriture ?
Parler, avec la respiration, avec la mélodie, avec la musique d’une parole, rythme le propos et participe de la signification. Et si nous examinons la structure de cette unité que nous appelons une phrase, le grammairien y place en son coeur un verbe, avec son sujet et son complètement. Le linguiste fait le pas d’y situer un shifter, un embrayeur, ou mieux, un sujet de l’énoncé, représenté par le “je”, et un sujet de l’énonciation qui, au-delà du dit, témoigne de la place d’un dire. Remarque très précieuse dont les analystes font usage en y situant une expression de la division du sujet parlant.
À l’examen, le déroulé d’une phrase met en jeu une suite de phonèmes, qui en assurant une signification, voire fait écriture.
Mais ceci dans des conditions tout-à-fait remarquables sur lesquelles il nous faut prendre le temps de nous arrêter. Marc Darmon aimait avancer cet exemple : prenez votre plume et commencer à écrire cette phrase articulée qui s’initie d’un “Je l’apprends…” vous vous trouvez frapper d’une hésitation bienvenue, “Je l’apprends…”ou”Je la prends…”. Comment l’écrire ? Seule la fin de la phrase, par la ponctuation et en proposant une signification, vous permet d’en faire tomber une écriture :
”Je la prends…par la main “ ,
”Je l’apprends…par cœur”.
Le dire d’une phrase est habité par un phénomène d’anticipation temporelle qui tient au fait même de nouer les dimensions du symbolique, de l’imaginaire en faisant sens, et dans la langue, signification, d’où une écriture possible en tombe, garante de ce nouage. Ce qui semble être le propre d’une ponctuation.
Nous pouvons alors soutenir qu’il y a là le témoignage d’une fonction au travail. Fonction qui intéresse l’analyste au plus haut point puisque sa mise en jeu est susceptible de faire série, c’est-à-dire d‘ouvrir et soutenir une succession de phrases, et de contribuer à donner au monde de nos représentations sa texture. Une manière de conjoindre et d’articuler le multiple à la dimension du Un, ici le Un d’une signification en jeu dans une phrase.
De cette fonction, il est bien difficile d’en donner une écriture et c’est seulement de son fonctionnement que nous pourrions en inférer une hypothèse . L’hypothèse d’une fonction, et de son éventuelle symbolisation.
La clinique,avec nos patients, les Mémoires du Président Schreber, la littérature avec James Joyce ou, comme nous l’a appris ce matin Marie Jejcic avec Samuel Beckett, témoignent, chacun par des voies singulières, de l’importance existentielle des enjeux de cette question. Lacan, qui nous introduit à ces remarques, y lit les enjeux de la métaphore et de sa symbolisation pour le sujet parlant, la métaphore paternelle, en évoquant le fameux “point de capiton”.
C’est par la mise en jeu de cette fonction que nous allons pouvoir parler, soutenir des phrases successives, construire le champ de nos représentations et entrer dans un récit,…ou pas. Ce qui viendrait témoigner de la présence de la symbolisation de cette fonction au principe de cette texture, ou, au contraire, de son défaut.
Et c’est à cet endroit que la littérature, notre clinique, l’enseignement de nos patients, deviennent très précieux.
En suivant Lacan, depuis les premiers travaux littéraires d’Aimée, nous avons en effet cette intuition, jusqu’à ses dernières élaborations avec le sinthome, et en suivant Freud, qu’au lieu même du défaut de cette symbolisation qui noue et ponctue, se propose un savoir-faire inventé, qui porte sur le tissage et le nouage d’une réalité, certes “délirante”, mais d’une réalité.
Celle-ci, cette invention, non seulement s’invente, mais se déplie dans des conditions bien spécifiques que je vous propose d’examiner à partir de ce qu’il est convenu d’appeler “les phrases interrompues” de Schreber.
Comment lire ce savoir-faire ?
Il décrit un mécanisme par lequel l’élaboration de principe même, de cette description, passe et dont il est le produit, comme l’ensemble du texte de ses Mémoires, avec, proposés en italique dans notre traduction, les premiers concepts d’une “Grundsprache” dont il aurait la charge, une langue enfin Une.
Une première partie de la phrase, réputée être celle du sujet de l’énoncé, s’impose à Schreber par la Voix extérieure, qui commande et initie impérativement la phrase avec ce Un énigmatique de signification à satisfaire.
Et puis cette suspension, ce laisser-tomber que Schreber, ne peut, devant l’insondable déchirement spatio-temporel ouvert, ne peut que combler, en complétant par le sens la signification appelée. D’où une seconde Voix, cette fois-ci jugée intérieure, au principe de cette obligation de penser, avec cette
étrange impression de penser quelque chose que l’autre persécuteur a déjà prévu et anticipé…
“Maintenant je vais me…/…
rendre au fait que je suis idiot “.
En situant au lieu de cette barre /, un scilicet, c’est-à- dire, quelque chose comme un “à savoir”.
L’ensemble du travail d’écriture de Schreber, qui constitue ses Mémoires, est le produit de ce dispositif qu’il finit, à un certain moment de son parcours, par isoler et dont nous pouvons faire la lecture. Il y a là un dispositif d’écriture, dont, comme chez Joyce, chez Beckett, ou chez d’autres, nous pouvons faire l’hypothèse, et qui donne à l’écriture un statut sinthomatique. C’est-à-dire le statut d’un savoir-faire, qui au lieu même où une symbolisation de la fonction de la métaphore sollicitée rencontre son défaut, invente, par l’écriture sous commandement xénopathique, les voies d’un auto-engendrement.
Ces voies schreberiennes ont cette particularité de se présenter dans le statut d’un “dualisme”. Et non pas d’une dualité ! Ce principe ne repose pas sur la qualité des termes en jeu, à savoir les caractéristiques d‘Ariman ou d’Ormuzd, par exemple, mais sur le seul principe en jeu qui spécifie le dualisme, à savoir leur opposition radicale et incommensurable dont il fait l’épreuve et à laquelle il ne peut pas ne pas répondre. Les espaces divins sont en guerre et il est appelé à en restaurer l’unité par la voie de la féminisation. Le dispositif des phrases interrompues en est l’expression. Et c’est pourquoi, au coeur de ce système, en place et lieu de ce scilicet, il s’identifie à l’énigme en répondant à cet appel en restaurant l’éternité divine perdue: une langue, la “Grundsprache”, avec l’élaboration progressive de ses différents concepts.
Il importe que chacun puisse en faire sa lecture, puisse refaire ce parcours de lecture, et donc d’écriture.
Le travail d’une cure analytique serait-il autre chose qu’apprendre à lire, à lire le travail d’une fonction qui trouve, à l’occasion d’un transfert, à se déplier. Certes ici, avec Schreber et quelques autres, à lire les enjeux d’un savoir-faire qui s’invente.
Melman rappelait, à la suite de Lacan d’ailleurs, comment la logique du signifiant était au coeur des élaborations de Schreber. La mécanique des phrases interrompues ne vient-elle pas en témoigner, en nous la faisant toucher du doigt dans l’actualité du dualisme schreberien, en mettant, ici, au centre, ce lieu “cause” énigmatique. Ceci permettrait-il d’éclairer nos embarras à la lecture de ce texte, texte dont nous ne voulons, jusqu’à aujourd’hui, rien savoir? Notre rapport à ses écrits viendrait-il en témoigner et nous donner une petite indication des enjeux de cette lecture, en lien direct aux enjeux liés à la lecture de l’inconscient?
Alors quelle lecture en proposer ?
Avec J.Lacan et la ponctuation de son parcours en 1966 avec la topologie des surfaces, celui-ci nous propose un texte, en 1972, “L’étourdit”. Un texte écrit, à lire comme un exercice de topologie. Il y est question de la topologie de la bande de Moebius et de ses différentes coupures. Avec cette topologie, et en en suivant ce qui rythme et fait un parcours, nous pouvons assez facilement y lire les enjeux de la clinique des phrases interrompues.
Les développements donnés au “syndrome du mur mitoyen” décrit par Charles Melman touchent à cette lecture. En effet une bande bilatére, à deux tours (BB2T), par recollement bord à bord, ou par superposition et recollement des deux feuillets, donne une bande de Moebius, c’est-à-dire la coupure même, celle qui spécifie l’ordre signifiant (inversement la coupure par le milieu d’une BM donne une BB2T).
Lacan nous en donne déjà une préfiguration dans son schéma I des “Ecrits”. En effet l’appui pris,dans une première boucle, contre la voix extérieure, se redouble, sur la deuxième boucle, d’un appui pris, cette fois-ci, sur une voix intérieure. Or ces deux voix, en opposition radicale, sont l’expression du dualisme dont Schreber se soutient avec le consentement à la mission asymptotique de le restaurer.
Voilà une indication et je n’ai pas le temps aujourd’hui, ni ne peux aller au delà dans ces commentaires.
À cette topologie qui noue Symbolique et Imaginaire, deux registres en opposition, Lacan va nous dire que ceux-ci ne peuvent aller sans un troisième.Il est possible là, d’une certaine manière, de pointer l’appel xénopathique auquel est soumis, sans pouvoir y résister, Schreber, ou celui, très bien décrit ce matin par Marie Jejcic à propos de Samuel Beckett.
Avec le pas de l’écriture du Réel, au lieu même de cette faille radicale, R, Lacan noue par l’écriture le réel, qui prend l’écriture d’une consistance. Une même consistance, R, noue borromennement S, et I. Il pointe là, avec son écriture, une “autre écriture”, celle dont il était question cette après-midi. Une écriture qui ne descend pas du signifiant. Celle-ci est autonome et acéphale. Elle ne peut être l’expression du sujet puisque celle-ci le déplace et le renouvelle, et, en mettant en jeu les dimensions du temps, en précipite un nouveau représentant. Le temps logique nous en propose, avec ses deux scansions, un premier parcours.
Cette “autre écriture” a la spécificité d’être homogène aux voies de la jouissance. Pour en prendre une toute première mesure Il suffit de penser à la mise au travail du symptôme et à ses remaniements dans une cure analytique par la mise en jeu de cette “autre écriture”, ou encore aux miracles schreberiens de l’incarnation qui tissent son corps clivé d’une jouissance féminine.
Il importe de pouvoir lire et repérer cette même topologie, à chaque fois en jeu par des voies singulières, au cœur de tout processus d’engendrement.
Que celle-ci soit symbolisée, et nous avons alors, pour le sujet, avec la métaphore paternelle, le refoulement originaire décrit par Freud et la longue série des refoulements secondaires.
Que celle-ci ne soit pas symbolisée et cette “autre écriture”se présente alors dans les modalités xénopathiques dont nous venons de parler.
Il est à noter que, s’il n’y a pas d’énonciation collective , le social ne peut que se présenter dans des modalités semblables que chacun, au un à un, est appelé, au mieux, à nouer.
Avec la ponctuation de son parcours de la fin des années soixantes Lacan nous propose une revue Scilicet, revue de l’Ecole freudienne. Celle-ci relève d’un projet tout à fait analogue, animé par une même logique.Et il importe de s’y arrêter. Que dit cette revue ? “Tu peux savoir…Scilicet…Ce qu’en pense l’Ecole Freudienne de Paris “, avec, dessiné, une bande de Moebius et ses traits de coupure, ou recollements. Une revue exactement conçue dans la logique des phrases interrompues ! Je laisse à chacun ses conclusions quant à la présence, dans cette revue d’une seule signature, celle de J.L.
Autre point à mentionner, le travail du mythe, avec le chaman, semble être de cet ordre. Et Claude Lévi-Strauss rend compte de l’engendrement des mythes, qui spécifie le mythe, en faisant valoir un dispositif tout-à-fait semblable qu’il formalise dans sa fameuse formule canonique.
De son côté, rien d’étonnant à ce que Freud se saisisse, dans ses premiers pas, du mythe avec son “efficacité symbolique” à lui, tout en donnant déjà à entendre, à lire, à son lecteur, dans le jeu de ses entre-deux, la logique en jeu dans un dire.
Voilà, et peut-être y êtes vous sensibles, ce que je peux lire et formuler de cette ponctuation en ponctuant ces journées.
Ceci n’est pas, ce repérage, sans vectoriser le travail du collège.
À savoir, une nouvelle fois, l’importance donnée aux présentations cliniques, et puis surtout un style de travail.
En effet si ce lieu “cause” pour chacun, et collectivement, relève d’un impossible, et non d’une énigme ou d’un renoncement, notre travail relève d’un impossible que nous pourrions qualifier, une nouvelle fois, d’impossible joyeux et tranquille. Et peut-être, ainsi, plus facilement dégagé de tout enjeu narcissique et de tout effet de prestance.
À très bientôt.